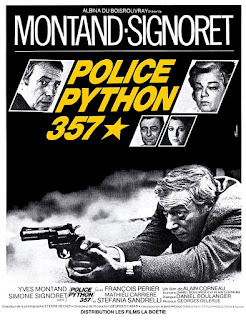|
| John Wayne dans La Piste des géants de R. Walsh |
Le cinéma
américain s’est toujours fait l’écho des idéologies dominantes, des pensées
politiques et des événements traumatisants qui ont traversé l’histoire du pays (1).
Et le genre
majeur qu’est le western (qui constitue « le
cinéma américain par excellence » disait A. Bazin) s’inscrit dans
l’idéologie de la Frontière, idéologie très en vogue à la fin du XIXème
siècle alors que la conquête de l’Ouest s’achève et que, dans le même temps, le
cinéma apparaît.
Le mythe de la Frontière :
Ce mythe est formulé par Theodore Roosevelt qui oppose
la sauvagerie et la civilisation. Il met en avant un racisme impérial, qui
s’oppose à l’Indien. Pour lui, il y a une régénération de la société par la
violence.
Ce mythe est complété par les idées de Frederick
Jackson Turner qui idéalise l’Ouest (qu’il oppose à l’Europe,
d’où sont issus les colons et qui est
rejetée) et insiste sur les qualités nécessaires pour « prendre la
route » et partir à la conquête de l’Ouest.
La Frontière devient ainsi le lieu
de la Nature sauvage, de la wilderness,
qui est à la fois emplie de mille dangers (selon Roosevelt), avec ses déserts,
ses serpents à sonnettes et ses Indiens ; et un lieu sacralisé (selon Turner)
dans lequel le Blanc peut se régénérer.
Dès lors la confrontation à la Frontière est à
l’origine de la civilisation américaine.
Cette idéologie
colonisatrice, de conquête et de civilisation d’une Terre sauvage sera au cœur
de mille et un westerns classiques, du Cheval de fer à Stagecoach en passant par La Piste des géants ou Le Grand passage.
C’est ce qui
fait du western LE genre de l’impérialisme américain, au moins jusque dans les
années cinquante et la fin de l’âge d’or du cinéma américain. Cette idée recoupe bien sûr celle d'une prise en charge par le western du récit de la nation (thématique abordée dans un article précédent).
La Nouvelle Frontière :
L’idéologie de
la Frontière revient sur le devant de la scène idéologique et politique
lorsqu’elle est convoquée, au début des années 60, par JFK notamment, pour de
nouvelles explorations : l’exploration spatiale mais surtout la guerre au
Vietnam. Le continent américain étant maintenant civilisé, ce sont de nouvelles
Frontières (l’espace infini et inconnu, la forêt emplie d’ennemis du Vietnam)
qui sont les wilderness modernes.
De nombreux
films travaillent ce motif : Bérets
verts de J. Wayne ou Star Trek de
R. Wise.
Le révisionnisme du mythe de la Frontière :
Mais la
catastrophe du Vietnam décrédibilise le mythe de la Frontière et
entraîne une critique très forte à partir de la fin des années 60. Les perceptions
changent du tout au tout : la figure de l’Indien est réhabilitée, son génocide
est évoqué. Et il y a une reconnaissance de la primauté de l’Indien sur le
colon Blanc qui est décrit comme un impérialiste violent. On se détourne alors de
la civilisation dont le progrès est source de violence pour se tourner vers la
Nature (2).
La violence – et
par-là même le mythe de la Frontière – est décrite non plus comme régénératrice
mais comme dangereuse pour la civilisation : il y a une dégénération par
la violence qui transforme l’homme civilisé en assassin. Dès lors il faut abandonner
les conquêtes qui ne sont que violences.
Dans Le Voyage au bout de l’enfer, la
violence de la Frontière détruit Mickael et ses amis. Ils ne reviennent pas
régénérés de la Frontière mais détruits.
 |
| Le Soldat bleu de R. Nelson |
Une autre idée
apparaît également, en marge de ce révisionnisme. C’est celle qu’il y a, au
cœur du territoire américain clos, la survivance de Frontières sauvages, comme
si tout le territoire n’était pas entièrement civilisé. Ces Frontières sont marquées
par la présence de Blancs sauvages qui sont en fait les héritiers, délaissés et
perdus dans la Frontière, des colons primordiaux. Ce sont des Blancs du Sud,
des rednecks débiles ou consanguins. Des films comme Delivrance les mettent en scène, avec, à sa suite, de nombreux
films d’horreurs (Massacre à la tronçonneuse par exemple), apocalyptiques ou de zombies.
Le Contre-mythe de la Frontière :
On constate
une restauration du mythe de la Frontière à partir de la fin des années
70. Il s’agit d’un
courant idéologique qui réhabilite l’Amérique. Il est centré sur le
Vietnam et cherche à effacer la tragédie :
- il justifie
l’intervention (il faut bien aider les Vietnamiens opprimés par les
communistes) ;
- il justifie la violence américaine par la sauvagerie de l’Indien/Viêt-Cong.
Ce courant
idéologique cherche à dépasser une importante contradiction : une fin humaniste
(se battre pour la liberté ou pour des opprimés) justifie des moyens impériaux
(et donc violents : l’utilisation du napalm par exemple).
De nombreux
films expriment ce courant de pensée, mais avec plusieurs différences par
rapport au mythe de départ, lorsqu’il était exprimé dans les westerns :
- le film n’est
plus raciste ou expansionniste. Il met en scène des héros proches des
Indigènes, qui combattent pour défendre des valeurs universelles contre
l’impérialisme de leurs ennemis ;
- le progrès
technique y est vu comme une menace ;
- le héros
résiste à l’empire et se place du côté des faibles ;
- la Nature
n’est plus un espace à conquérir mais un écosystème à préserver.
C’est ainsi que,
dans Rambo II, des villageois
vietnamiens subissent le joug du Viêt-Cong barbare ce qui justifie
l’intervention américaine. Rambo lui-même est indianisé : par son look
(bandeau), ses armes (arc), il connaît la forêt et l’utilise pour détruire
l’ennemi.
Si Platoon dénonce la violence des troupes
américaines, l’ennemi est clairement désigné comme un Indien sauvage et barbare
et le héros Chris est nettement régénéré par la violence.
Dans Star Wars la Rébellion se bat pour
la liberté contre l’Empire. Le héros Luke est issu de la Frontière.
Dans Avatar : les Na’vis luttent contre
l’impérialisme militaro-mercantile pour préserver leur planète. Le spectateur
est du côté des Indigènes et le film critique violemment la conquête militaire, le progrès technique
et la civilisation qui lui est associée.
 |
| Avatar de J. Cameron |
La Guerre contre la Terreur :
Ce contre-mythe
de la Frontière sera convoqué à nouveau après le choc du 11 septembre 2001. Il s’agit d’une
reprise de l’idéologie de la Frontière (par G. W. Bush notamment) tout en
s’appuyant sur le choc des civilisations : on retrouve la distinction
raciale déjà présente chez Roosevelt (l’occident vs les Indigènes) mais
l’Indigène est, en plus, affublé de visées impérialistes. L’ensemble dessine
une Amérique menacée de toutes parts par des barbares.
On retrouve
cette idéologie exprimée dans American sniper, Zero Dark Thirty.
La série des Avengers ou les récents Superman (Man of Steel) présentent de nombreuses
destructions sur le sol américain. Ces destructions dues à un ennemi
terriblement barbare justifient la violence (exercées par les superpouvoirs des
superhéros) ou même la torture (par exemple dans Zero Dark Thirty).
Le cinéma
américain, en partant du western mais en faisant évoluer sans cesse le genre puis en débordant vers d'autres genres, se
fait ainsi constamment l’écho de l’Amérique, de ses traumatismes et de ses
inclinations politiques ou idéologiques. Cette façon pour un cinéma d’absorber
et de ressortir les événements qui constituent son histoire est d’ailleurs
infiniment plus marquante aux Etats-Unis qu’en France où, nous semble-t-il, des
auteurs ou des courants cinématographiques (on pense à La Nouvelle vague, très
germanopratine) passent au travers d’une époque et peinent à la filmer.
Notons enfin qu'à ces différentes versions cinématographiques du mythe, correspondent trois grands types de personnages : le
héros, le méchant et la victime (que va devoir sauver le héros des griffes du
méchant).
________________________________
(1) : On trouvera dans la thèse de H. Mayer « Guerre sauvage et empire de la liberté : Prolongements du mythe de la Frontière dans le cinéma américain post-western » (2016), des développements très riches et passionnants de ce qui est résumé ici.
(2) : Il
faut cependant noter que ce révisionnisme, en prenant le contre-pied du mythe,
raisonne de la même manière : décrire l’exact opposé d’une proposition,
c’est continuer de se référer à cette proposition.