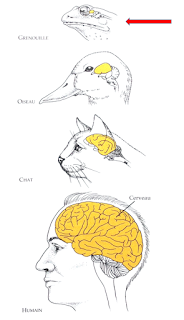Très beau film, très lent, tout en retenue et
en suggestion. Il aborde le thème classique de la rencontre amoureuse, sur le même
plan que D. Lean (Brève rencontre) ou
que C. Eastwood (Sur la route de Madison).
In the Mood for Love est aussi un brillant
exercice de style de Wong Kar-wai qui, avec une caméra chaude et douce, filme
merveilleusement cette relation entre Su Li-zhen et Chow Mo-wan. Relation qui n'en est
pas une : ils se croisent, se frôlent, se parlent avec peine, avec force
silence, comprennent ce qui les relie (leur mari et femme respectifs sont amants), mais sans jamais parvenir à s’extraire de leur situation. En fait Wong Kar-wai
filme une impasse.
La photo est sublime (souvent baroque), l’image
propose un champ très réduit (coinçant les personnages dans des couloirs, leur
laissant peu d’espace pour se croiser), la bande originale envahit le film. Wong
Kar-wai, dans des séquences de ralentis célèbres et éblouissants, parvient à
atteindre la grâce en magnifiant le quotidien. Aller chercher du riz – équivalent à Hong-Kong d'aller acheter une baguette – devient un moment de grâce. Maggie Cheung
ondule doucement dans sa robe qui allonge son corps.
Suprême virtuosité du cinéaste : quand bien même
il propose des images raffinées et parfaites, le hors-champ est fondamental, aussi bien en complément de l'image (par exemple on devine que Su Li-zhen et Chow Mo-wan se sont croisés en hors-champ) qu'en complément
de l'histoire (l'aventure des époux n'est jamais montrée, elle est pourtant
fondatrice du rapprochement de Su Li-zhen et Chow Mo-wan).