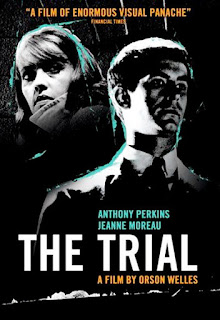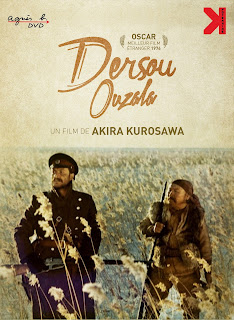Premier film véritablement
fellinien, dans lequel le style si particulier de Fellini explose. Le film est
sans scénario véritable, il montre quelques jours (le sait-on vraiment ?)
de la vie du journaliste Marcello (Marcello Mastroianni, parfait) et le film se
déroule au fil des épisodes, un peu comme une improvisation de jazz. Ces
différents moments sont autant d’images qui se succèdent, furieuses,
inventives, symboliques, baroques. Visages excentriques et vains de la vie
moderne trépidante, futilité de ces remous continuels : c’est un
foisonnement ininterrompu. Autant qu’un personnage, Marcello est un témoin
embarqué et il déambule dans la nuit, sans affect, superficiel, ballotté.
Le génie de Fellini s’exprime
pleinement dans ces images décalées, désabusées, futiles ou surprenantes. A un
petit chat qui erre dans une rue, succédera bientôt la frénésie
médiatique d’un attroupement dans un champ, avec échafaudages et
éclairages violents.
La célèbre séquence d’ouverture, à
la fois fraîche et incongrue, avec la statue du Christ emporté par un
hélicoptère qui passe au-dessus de quelques femmes qui bronzent à une terrasse
et qui sont interpellées par Marcello, résume le film à elle seule.