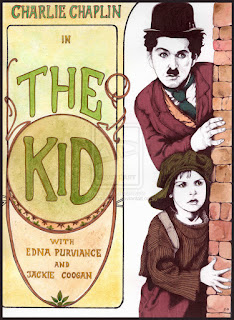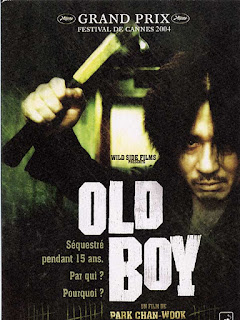Les Cahiers du Cinéma interviewent Mme M.- L.
Petit, inspectrice générale de l’Éducation Nationale en charge de l’enseignement
du cinéma dans le secondaire (numéro de septembre 2015) :
« […]
L’enjeu est aussi d’être en phase avec l’actualité puisque les films
sont dans les salles au moment où les lycéens les découvrent. N’est-ce pas là
un modèle à suivre pour l’enseignement du cinéma, qui a tendance à se replier
sur des œuvres sacralisées ?
Tout à fait. Ce sont aussi les problématiques
de l’enseignement de la littérature… Doit-on intégrer la littérature du 21e
siècle aux programmes ? On se pose la question pour les lycéens mais aussi
pour les concours de recrutement des enseignants. Avons-nous le recul
nécessaire pour dire que telle ou telle œuvre est un chef-d’œuvre ou pas ?
La question a été tranchée : oui, il faut y aller. Et c’est le signal qui
a été donné par les concours. Pour le cinéma nous devons aussi être dans cette
perspective. Si nous voulons construire un enseignement basé sur la réception
des élèves – ce qui est essentiel -, nous devons partir de films qui sont
proches d’eux pour les amener ensuite vers d’autres œuvres.
On peut se demander si les professeurs de cinéma, sans doute parce
qu’ils sont en quête d’une certaine crédibilité, n’ont pas tendance à se
replier sur ce qu’ils connaissent. De la même façon, certains sont timorés
quant à la question de la grammaire cinématographique… Il y aurait donc,
paradoxalement, une forme de conservatisme dans l’enseignement du cinéma ?
C’est certain. Depuis deux ans et demi que
j’ai ce dossier en main – et je n’en avais aucune connaissance avant d’entrer à
l’inspection générale de l’Éducation Nationale – je trouve que toutes les
problématiques et tous les combats qui ont été menés en lettres sont
aujourd’hui ceux de l’enseignement du cinéma, avec vingt ans de décalage. On
retrouve les mêmes réflexions, les mêmes avancées, les mêmes points d’achoppement.
Désormais, en lettres, le prof à la mode est celui qui travaille sur la
littérature du 21e siècle. On y arrivera peut-être pour le cinéma.
[..] »
Ce n’est pas une surprise mais c’est tout de
même triste à lire : l’inspectrice veut appliquer au cinéma les mêmes
idées que pour l’enseignement de la littérature. Or cette façon de faire, en
œuvre depuis trente ans, est une catastrophe. Non pas que l’inspectrice ne le sache
pas, mais elle est idéologue. Et une idéologie, comme elle ne provient pas des
faits, ne peut être contrariée par les faits.
L’interview est donc éclairante : pour
enseigner le cinéma il faut faire l’exact opposé de ce qu’elle préconise. En
effet il ne faut pas partir de ce que les élèves connaissent, bien au contraire (on tient là une erreur de conception de
toute l’Éducation Nationale depuis trente ans) : il faut au contraire les
surprendre, les brusquer, les choquer (dans le sens de « recevoir un choc »). Il
faut donc leur montrer des films qu’ils ne connaissent pas et, bien plus,
qu’ils ne connaîtront jamais (je parle ici d'élèves qui n’ont pas, chez
eux, des parents pour leur montrer ces films).
Eh oui, une des grandes spécialités de
l’Éducation Nationale est de mettre la charrue avant les bœufs. N’en déplaise
aux idéologues, il ne faut pas avoir peur des élèves, il ne faut pas
sous-estimer leurs capacités à recevoir quelque chose qu’ils ne connaissent
pas. D’autant plus que, le plus souvent, dans les clubs cinéma, ateliers cinéma
et autres options cinéma, il s’agit d’élèves volontaires et curieux.
Alors ne pas mettre la charrue avant les bœufs,
c’est éviter de partir des films actuels. Non pas qu’il n’y ait pas de chefs-d’œuvre
aujourd’hui, là n’est pas la question, mais c’est que la plupart des élèves
aiment le cinéma (pour ce qu’ils le connaissent) et ont une culture cinéma (la
leur, faite de Star Wars et de Hunger Games, ou de 16 ans ou presque et de Hollywoo). Alors il faut aller vers un autre cinéma, celui qu'ils ne connaissent pas, celui auquel ils ne se sont jamais frottés. Il faut les confronter à des films en noir et blanc et en VO (ou muets même), à des jeux
d’acteur désuets, à des balles qui ne font pas de violents impacts de sang, à des
personnages qui se séduisent parce qu’on ne peut montrer du sexe à l’écran,
etc.
La Vie est belle (Capra), L’Aventure de Mme Muir, La Prisonnière du désert (quelle
horreur, un western – même pas italien –, vous n’y pensez pas !), La Mort aux trousses, Certains l’aiment chaud, La Fureur de vivre, Le Parrain, Le Grand sommeil,
Les Diaboliques, Chantons sous la pluie, Voici le temps des assassins, Jeux interdits, La
Nuit du chasseur, etc. Autant de films éblouissants qu’il faut montrer à
des collégiens. Et le Cinéma dispose même, en Chaplin, d’une entrée facile et
prodigieuse vers le muet. Eh oui, l’inspectrice semble l’ignorer, mais les
collégiens accrochent à de tels films, sont captivés et ils sont surpris, même,
qu’un vieux film puisse leur plaire et puisse leur parler à ce point. C'est là qu'on entrouvre une porte merveilleuse dans l'esprit des élèves.
Las, on ne doute pas que l’idéologie prônée
par l’inspectrice, délétère pour la littérature, le soit aussi pour le cinéma…