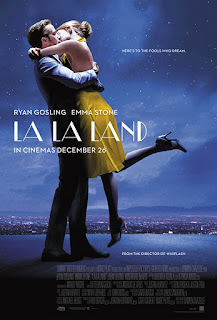Dans son deuxième long métrage, Damien
Chazelle nous emmène du côté off de la scène, dans les méandres d’une école de
jazz réputée, lors des répétitions et de l’apprentissage d’Andrew, jeune
batteur qui veut percer. Si Damien Chazelle cherche à capter quelque chose de
la virtuosité des artistes il passe pourtant, nous semble-t-il, à côté de son
sujet.
En effet Whiplash, essentiellement didactique, illustre les sacrifices
demandés ou attendus pour parvenir à réaliser un rêve. Mais le film souffre de
n’être qu’une illustration : il ne cherche pas à émouvoir musicalement et
l’on voit Andrew dans ses efforts, ses échecs et ses réussites, ses espoirs et ses
déceptions, mais on ne le voit pas dans une dimension artistique. Il n’y a pas
d’émotion dans ce qu’il produit. Le spectateur n’est pas non plus le public que
le film refuse obstinément au jeune batteur : seul Terence Fletcher,
l’intransigeant chef d’orchestre, est son juge.
De sorte que le sous-entendu du film est
tout de même surprenant : il confine l’aboutissement du musicien à la
virtuosité technique. Comme si Charly Parker – dont il est souvent question dans le film
– n’était qu’un virtuose. Non bien sûr, loin s’en faut, il était bien
davantage : il possédait un génie créatif, tout ce qui ne s’apprend pas, tout ce
qu’avaient, en réalité, les grands musiciens de jazz dont nous parle le film. Mais il n’y a rien de tout cela
ici : mesurée par le terrible Fletcher, seule la capacité du batteur à
tenir un rythme complexe ou très rapide sera décisive. Certes le bebop se voulait une apothéose technique (a contrario, justement, du cool jazz contre lequel il s'élevait) mais le musicien, réduit dans Whiplash à
une unique dimension technique, apparaît comme un simple artisan performant mais
non pas comme un artiste.
Et l’on reste circonspect devant ce
Fletcher jusqu’au-boutiste qui a tout du sergent Hartmann (Full Metal Jacket est clairement cité). Il exige la perfection
technique et reste seul maître du choix (encore une fois exit ici le public, ce qui est curieux concernant le jazz).
Et le film, donc, concentré sur la quête
purement technique de son héros, oublie lui aussi la dimension émotionnelle. Ne
saisissant pas le médium cinéma pour filmer la musique en train de se faire –
c’est-à-dire montrer l’empreinte du génie créatif et l’émotion musicale – le film
ne dépasse pas, émotionnellement, les déboires psychologiques de son
personnage. La musique est à peu près nulle part émotionnellement.
On mesurera l’écart avec des films comme
Amadeus ou Tous les matins du monde qui, dans des styles et avec des ambitions
très différentes, sont emplis de musique, avec All That Jazz (pour rester dans les coulisses d’un spectacle qui se monte), avec
Bird (plusieurs fois cité, qui
cherche à capter quelque chose de la musique de Charly Parker) ou encore, pour
montrer combien le cinéma peut se saisir d’un art et en faire un véritable objet
cinématographique, avec Les Chaussons rouges de Powell.