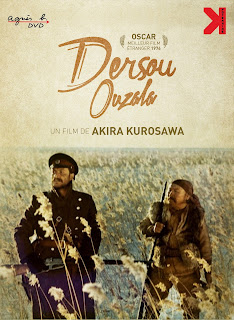Très grand film
d’Akira Kurosawa, qui, sous couvert d’un film policier noir parfaitement mené, propose
un regard social terrible sur le Japon de son époque.
Dépassant
allégrement l’intrigue policière (passionnante par ailleurs), Kurosawa allie
avec génie le fond et la forme : il découpe son récit en plusieurs grands
moments, auxquels sa mise en scène s’accorde à ce qu’il veut montrer.
Commençant en
laissant le spectateur enfermé dans les grandes pièces de la maison luxueuse de
Gondo, Kurosawa joue d’une géométrie parfaite, utilisant la puissance des corps
des acteurs comme autant de pivots autour desquels il tourne. Les personnages,
sans cesse, sont dos à dos, s’inclinent, se détournent, fixent le mur tout en s’adressant
à un autre, sont séparés par autant de lignes droites qui viennent découper le
plan. Déjà Kurosawa met en scène la tragédie qui se joue, entre Gondo, le riche,
et le chauffeur, dont on a enlevé l’enfant par erreur. La mise en scène dit
tout ce que les personnages ne disent pas directement : le rapport de
domination entre le patron et l’employé ; l’humanisme évident de Gondo qui
est parti de rien, qui est détesté pour cela et qui va finir ruiné. Kurosawa,
qui manie avec une telle facilité les grands espaces et les mouvements exaltés,
déploie un génie incroyable dans ces séquences où l’on reste confiné à quelques
pièces.
Le film,
ensuite, nous conduit dans la fabuleuse séquence de la remise de rançon, à bord
du train en mouvement, sans une pause, et avec cette idée des caméras qui scrutent
au dehors, formant des films dans le film, rajoutant au côté improvisé,
trépidant et tout en mouvement de l’action dans cette séquence incroyable.
Le film, alors,
se déploie dans toute la ville, où l’on suit l’enquête des policiers (organisés
autour de Tatsuya Nakadai, qui partage l’affiche avec Toshiro Mifune pour la
troisième fois de suite chez Kurosawa, après le diptyque Yojinbo-Sanduro). Et, au
travers de l’enquête, qui nous fait croiser le meurtrier puis nous rapprocher
de lui pas à pas, on découvre la ligne rouge du film, qui n’est présente d’abord
qu’en filigrane puis que l’image vient exposer toujours davantage : le riche
Gondo, dans sa villa qui domine la ville, face à la pauvreté, aux maisons
délabrées, aux métiers pénibles.
Et Kurosawa,
enfin, nous plonge dans les bas-fonds de la ville, changeant une nouvelle fois
de style, traquant la pauvreté comme les policiers traquent le coupable,
plongeant dans les bars dansants, où l’ivresse, le sexe et les drogues se
mélangent, jusqu’à ce cloaque où le tueur (que l’on n’entendra jamais parler
avant la scène finale) vient chercher une femme perdue, achevant sa trajectoire – du haut jusqu’en
bas ; du paradis à l’enfer – mais sans la lourdeur du film à thèse, sans
le manichéisme partisan : Gondo est issu de ces bas-fonds, il s’est hissé
en haut, le voilà projeté en bas à nouveau ; il devient populaire en
sauvant le fils de son chauffeur (leurs enfants jouent ensemble, ce qui met à
bas le regard de prétention que l’on prête à Gondo), ce qui le ruine… Mais,
déjà, il est prêt à repartir et à fonder une nouvelle entreprise. Ce personnage
– à qui Toshiro Mifune donne toute sa puissance de jeu – est remarquable de
complexité et d’humanité rentrée (il faut voir comment il explique à sa femme –
dont on comprend qu’elle n’a connu que la richesse et qui l’incite à payer
immédiatement la rançon et donc à se ruiner – que la pauvreté est dure et que
si lui la connaît elle ne le supporterait pas). Mais que l’on est loin, dans
ces séquences dans les enfers de la ville et de la condition humaine, de l’harmonie
luxueuse des débuts, avec la femme de Gondo en kimono traditionnel.
La séquence finale, dans la prison, est extraordinaire et mériterait une exégèse à elle seule, avec un Gondo silencieux devant le meurtrier qui libère sa parole avant de hurler son désarroi et sa haine, avant que le rideau de fer ne tombe, scellant les deux Japons qui, nous dit Kurosawa avec amertume, ne se comprennent pas.
Entre le ciel et l’enfer, on l’a compris,
est un film exceptionnel qui montre combien Kurosawa, entre le chanbara ou les
grands espaces (des Sept samouraïs à Ran), est aussi capable de passer au
crible de sa caméra géniale les villes avec leurs complexités et leurs
bas-fonds (depuis Vivre jusqu’à Dodes’kaden) en passant par le polar
depuis le très bon Chien enragé jusqu’à
ce film majeur, qui reprend tant de motifs du cinéaste.
On retrouve l’influence
du film aussi bien dans les méandres de l’enquête policière du Vase de sable de Yoshitaro Nomura que dans
le regard social, tout en verticalité, que l’on retrouve dans le récent Parasite de Bong Joon Ho.
Cette suite du Garde du corps n’en est pas vraiment une :
si elle reprend le personnage de samouraï de Sanjuro, toujours campé avec force
par Toshiro Mifune, le scénario, lui, repart sur de nouvelles bases. On
retrouve aussi Tatsuya Nakadai, qui fait le rôle du grand méchant qu’il faut
affronter.
Mais si le film
se suit sans déplaisir, il est loin des sommets du genre. Il déroule en réalité
plusieurs passages obligés dans cet affrontement de clans, avec de belles idées
(les fleurs de camélias qui flottent dans la rivière d’une maison à l’autre).
On s’attardera, néanmoins,
sur l’impact visuel du duel final, où les deux samouraïs s’affrontent et que Kurosawa,
à rebours des codes habituels qui offrent un long combat en forme de climax, règle
très rapidement. Mais ce duel est appuyé par une gerbe de sang aussi violente
que soudaine, qui vient contraster avec les duels qui, jusqu’alors, avaient
épargné la vision de la moindre goutte de sang. Et c’est à partir de cette
image choc que les films de sabre japonais, chinois ou hongkongais – ceux de
King Hu, Chang Cheh et autres Toshiya Fujita – rivaliseront de gerbes de sang
qui jailliront à tout instant.