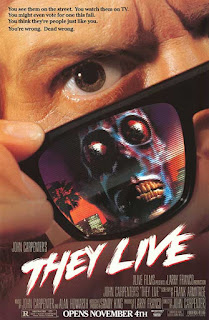Extraordinaire film de Andrei Tarkovski,
qui emmène le spectateur dans un univers décalé, étrange, fait d’irréalité et
de sensations.
Comme souvent avec Tarkovski, le
rythme est très lent, il impose son formalisme, ses lents mouvements, ses
personnages qui errent dans un univers étrange, ici une « zone » où
des évènements mystérieux se déroulent, sans que tout soit bien identifié. Cette
zone est traversée par deux hommes, accompagnés par leur guide – le stalker
–, qui les emmène au cœur même de la zone, dans une mystérieuse chambre où, parait-il
tous les vœux sont exaucés.
Le film, en faisant pénétrer les
protagonistes au sein de cette « zone », est un parcours initiatique,
conçu comme un passage vers un ailleurs mal défini. Dans la zone le monde semble
arrêté, le temps ne s’écoule plus. Et, dans la chambre, au cœur même de la
zone, on est dans un monde de rêve (la chambre existe-t-elle seulement ?).
Ce film à la fois lent et dense est
difficile : on peut tout à fait passer au travers et s’ennuyer ferme, on
peut aussi entrer dans la zone, guidé par le stalker, et contempler les lentes
méditations de la caméra qui se perd dans les ruines, dans l’eau des flaques,
dans les hallucinations des personnages. La désolation de la zone contrastant d’ailleurs
avec la beauté formelle des images.
L’œuvre est typique de Tarkovski en
incitant à la réflexion : on est aux confins de la métaphysique et on sent
bien que Dieu est absent de cette zone, qu’il ne sera d’aucun secours pour les trois
personnages quant à leurs espoirs, leurs illusions ou pour offrir un autre
possible. Cette partition entre monde extérieur, la zone et la chambre cachée au
cœur de la zone offre un entrelacs entre réel (le monde), irréel (la zone) et
idéal (la chambre). On a ainsi un idéal (une chambre où nos vœux sont exaucés !)
caché au cœur de l’irréel. Pour atteindre son idéal, il faut donc détruire la
raison, la rationalité, la signification logique des choses.
Et au milieu de cet univers de
sensation qu’est la zone, le stalker, pragmatique, qui connaît quelques règles propres à la zone qui permettent de la traverser, met en garde les personnages qui l'accompagnent : l'un est écrivain, il ne croit pas en la capacité de la chambre de réaliser tous les désirs, l'autre est scientifique et veut, lui, détruire cette chambre secrète.
 |
| La chambre, au cœur du cœur de la zone |
On entre alors dans ce film comme on
entre dans une cathédrale : on est englobé dans un ailleurs étrange où le
temps se fige. On a cette impression de pensées qui sont mises en images. C’est
là qu’est le génie de Tarkovski : proposer une réflexion qui passe par la
poésie – austère et sombre – de l’image.