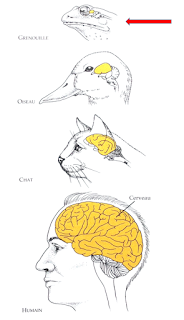Dans
de nombreuses interviews, beaucoup d’artistes (pas seulement les cinéastes),
aiment expliquer (ou laissent clairement penser) qu’ils ressentent le monde
différemment, qu’ils y captent ce que d’autres – ceux qui ne sont pas artistes – ne captent
pas. Qu’ils ont une acuité supérieure, en somme, à celle du vulgum pecus. Et, par là,
il faut comprendre que c’est ce qui rend l’artiste exceptionnel.
Nous ne
partageons pas du tout ce point de vue (point de vue qui, soit dit en passant, est d’un manque
d’humilité étonnant). En effet, ce qui rend un artiste exceptionnel n’est pas
dans sa capacité à ressentir, mais dans sa capacité à exprimer ce qu’il ressent, ce qui n’est pas du tout la même chose.
Cela dit, si
on peut trouver une réelle acuité et une réelle vibration dans de nombreux films
abordant différents thèmes (par exemple la rencontre amoureuse, filmée avec une
sensibilité éblouissante chez David Lean ou Clint Eastwood), il est des
domaines où l’artiste s'avère incapable de la moindre finesse.
C’est le cas de nombreux réalisateurs dont les films se veulent des dénonciations de la société actuelle qui
y est décrite comme tragiquement capitaliste et épouvantablement dure et
violente. Et, bien souvent alors, ils cherchent à se draper dans un
réalisme qui n’en est pas un. Généralement leurs films s'appuient sur des cas
particuliers, qui, s'ils existent réellement, sont des cas extrêmes.
Or créer une émotion à partir de cas extrêmes semble un peu facile et
artificiel, et raisonner à partir de tels cas est une erreur qui enlève tout
poids à l’argumentation.
Sans aller
jusqu’au militantisme d’un Costa-Gavras (dans Le Capital par exemple), des films comme La Loi du marché ou Deux jours, une nuit sont des exemples de films qui se veulent réalistes, mais qui
pâtissent de telles lourdeurs.
Les choix
scénaristiques ne relèvent pas du regard d’un artiste mais de celui d’un
partisan qui, pour mieux faire passer son message, s’appuie sur un cas extrême
non représentatif. A chaque fois le cas existe mais il n’en est pas réaliste
pour autant.
Dans La loi du marché il est question d’une
caissière licenciée parce qu’elle a ramassé dans une poubelle quelques coupons
de réduction : sur les dix mille pertes d’emplois quotidiennes en France,
ce cas est-il représentatif ? Ce cynisme violent du patron est-il
un exemple typique de la relation patron-employé ? Dans Deux jours, une nuit, si les collègues de
Sandra veulent conserver leur prime cela entraînera son licenciement. Cette terrible alternative proposée aux employées, si elle a pu exister, comment penser qu'elle est habituelle ou commune ? Est-il besoin de grossir à ce
point le réel pour être convaincant et toucher le spectateur ? Ces
cas extrêmes ne font pas partie de la vie de tous les jours, contrairement à ce
que le film cherche à nous faire croire.
On admirera, a contrario, le désastre qui frappe Antonio
lorsque sa bicyclette lui est volée dans Le Voleur de bicyclette. La puissance du film vient, entre autre, de ce que ce
vol infiniment banal prend une importance tragique. C’est au travers de ce banal
tragique que la société décrite par De Sica est violente et touchante. Tout au
contraire, la situation de Sandra est violente et désespérante parce que
l’alternative imposée à ses collègues est épouvantable mais elle n’est pas du
tout banale. C’est d’ailleurs là qu’est l’arnaque (aussi bien intellectuelle
qu’émotionnelle) en faisant croire que cette situation est tout à fait
représentative alors qu’elle ne l’est pas.
Si le
capitalisme est si violent et provoque tant de désespoirs, pourquoi s’appuyer
sur de tels cas ? Quel besoin d’utiliser des
miroirs à ce point grossissant ? Le miroir grossissant, par définition, n’est
jamais un gage de réalisme.
Sur un autre
thème, on pense aussi à Joyeux Noël,
qui cherche à nous faire croire, en s'appuyant là aussi sur un cas particulier, que les
soldats allemands et français, pendant la guerre de 14-18, ne demandaient qu’à
fraterniser sur les lignes de front.
A travers ces
quelques exemples, on comprend que le réalisateur – « l’artiste » – n’a, bien souvent, pas du tout une acuité de regard particulière et que sa prétendue capacité à
exprimer ce qu’il ressent est mise au service d’un objectif assez peu noble : émouvoir
le spectateur dans le but de lui faire ingurgiter, l'air de rien, un joli petit prêt-à-penser.