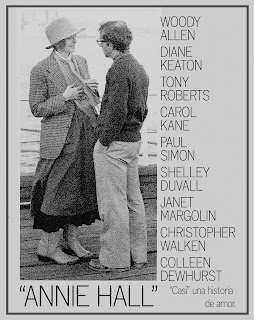Extraordinaire film
de Woody Allen qui propose une réflexion sur son art et la façon qu’il a de
s’articuler avec sa vie. Bien entendu le Huit et demi de Fellini n’est jamais très loin en toile de fond. Mais Woody
Allen parvient à transposer l’univers de Fellini dans son propre univers, ce
qui n’est pas rien, tant le réalisateur italien a une personnalité et un style
puissants. Mais cela montre aussi l’univers si particulier de Woody Allen, qui
n’a guère d’équivalent. Le film mélange alors, avec une inventivité et une liberté de tous les instants, des rêves, des films
dans le film, des moments drôles, des scènes étranges. La première séquence du
train est exceptionnelle et donne un raccourci saisissant de la condition
humaine, tout en illustrant la peur et le doute qui saisissent le personnage de
Sandy Bates (et bien évidemment Woody Allen lui-même).
Stardust Memories fascine par son jeu de tiroirs
multiples (c’est un film dans un film dans un film), avec, comme liant
supplémentaire entre ces différentes strates, Woody Allen lui-même, à la fois
réalisateur et interprète du rôle du réalisateur. On a là un jeu de miroirs supplémentaire
par rapport à Huit et demi puisque, quand
bien même Mastroianni est l’alter ego bien connu de Fellini, l’effet n’est pas
le même qu’avec Woody Allen qui est lui-même présent dans son film (avec par
exemple un fan qui porte un tee-shirt de… Woody Allen ou de Sandy Bates, on ne
saurait dire tant tout se confond).
Chez Fellini c’est
la capacité créatrice qui était interrogée. Chez Woody Allen, en revanche, la question pose, au travers de ce réalisateur
de films comiques qui ne veut plus faire de comique, c'est de savoir ce qui motive le
mal-être de l’artiste : provient-il de son regard sur le monde (avec ces immenses images
de l’Histoire qui s’imposent jusque dans son salon et devant lesquelles il
monologue longuement) ou bien ce mal-être émane-t-il de ses propres tourments internes
(nés de ses relations complexes, comme toujours, avec les femmes) ? Autrement
dit, ce bouillonnement vient-il de l’extérieur ou du plus profond de soi ?
Chez Allen, bien sûr, ce n’est pas le spectacle du monde qui l’assaille de
doutes et de questions, mais bien plus son désarroi personnel et profond. Il exprime ainsi par l'image ce qu'il a pu dire par ailleurs : « Presque tout mon cinéma est autobiographique : exagéré mais vrai. Je ne suis pas social. Je ne reçois pas grand-chose du reste du monde. J’aimerais sortir de là, mais je ne peux pas. »