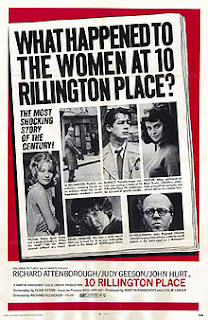Très grand film
de Richard Fleischer qui aura décidément réalisé des chefs d’œuvre dans des genres
très différents.
Avec Mandingo, Fleischer tire à boulets rouges
sur l’esclavagisme, en montrant la vie – et la façon de voir le monde surtout –
d’un père et de son fils dans une plantation. On est très loin ici du faste
hollywoodien d’Autant en emporte le vent ;
le film est même un contre-champ du célèbre film de Fleming, contre-champ à la
fois visuel et idéologique.
Il n’y a pas,
ici, de riche demeure flamboyante : la maison semble à l’abandon, les
pièces ne sont quasiment pas meublées, les couleurs y sont ternes (l’opposé de
Tara, la plantation de Scarlett O’Hara). Cette décrépitude – alors que les
affaires vont bien puisque la famille est riche – illustre la décrépitude
morale des Maxwell. À cette décrépitude s’ajoute le double claudiquement du
père et du fils, comme si leur tare morale se répercutait dans leurs corps.
Ce que le film
illustre parfaitement (et avec quelle violence !), c’est que le racisme
n’est pas seulement un ressenti de supériorité des Blancs ou une haine des
Noirs, il n’est pas seulement une opinion ou un défouloir sadique, mais il
structure complètement la vie – vie économique et vie sociale – des Blancs
esclavagistes.
La vie
économique est montrée au travers du commerce des esclaves, esclaves qui sont
totalement assimilés à du bétail, avec une évidence incroyable. On achète tel
esclave pour trouver un mâle reproducteur comme on cherche un étalon dans un
élevage, on le vend (en séparant des familles sans s’émouvoir une seconde) pour
en tirer tel ou tel profit. On le tâte, on l’examine comme on le ferait d’un
cheval pour s’assurer qu’il ne boîte pas. On laisse mourir sans coup férir un
bâtard illégitime.
On s’amuse avec
l’esclave, aussi, avec ces terrible combats à morts : on achète un
champion, on l’entraîne (avec quelle rudesse !), on se déplace pour aller
le voir gagner.
Fleischer montre
aussi combien la vie des Noirs est imbriquée dans celle des Blancs : c’est
au travers de l’esclavage sexuel – et non par l’exploitation au travail – que
le film va basculer.
Socialement le patriarcat
le plus rétrograde le dispute au racisme puisque le traitement homme/femme
est bien particulier : coucher avec une esclave noire fait partie du cours
normal des choses (quitte à faire un enfant : il n’y aura qu’à le vendre ou
s’en débarrasser) mais l’inverse n’est pas vrai puisqu’une femme blanche doit
être pure (et ne sera pas traitée sexuellement de la même façon). C’est
ainsi que, lorsqu’Hammond fait un mariage de convenance avec Blanche, il n’accepte pas qu’elle ne soit pas
vierge. Et s'approcher d'un homme noir est évidemment inadmissible et entraîne des punitions radicales.
C’est qu’Hammond
Maxwell, le fils de l’intraitable Warren (extraordinaire James Mason, à
l’esprit cadenassé par sa vision raciste des choses), est un personnage plus
complexe que son père. Il n’a pas ce racisme aussi violemment chevillé au
corps. C’est l’éducation du père et la structure sociale qui ont forgé en lui sa
relation aux Noirs, mais on voit que ses ressentis intimes sont différents.
S’il traite les Noirs en esclaves ceux-ci sont traités sans violences
exagérées. Et s’il punit Agamemnon, c’est sur l’injonction de son père et il ne
supporte guère de voir l’esclave battu (et il réagit durement contre son cousin
de passage qui augmente très violemment le châtiment). De même il n’accepte
guère la violence physique et sexuelle du même cousin sur une servante.
On remarquera
aussi que, au milieu de tant de perversion, on n’hésite pas à invoquer la
Bible, comme cette prière (« Je prie
le Seigneur de prendre soin de mon âme »), faite au bord du lit, nu et
à côté de l’esclave nue, après avoir tranquillement annoncé que l’enfant
qu’elle porte, produit de ses coucheries, sera vendu. On retrouve, dans Twelve Years a Slave, la même omniprésence
de la Bible qui est pervertie et détournée pour servir de socle moral à un comportement
épouvantablement inhumain.
Hammond franchit
une ligne jaune infranchissable par le père : qu’il couche à droite à
gauche avec les servantes noires, cela ne compte pour rien, mais qu’il puisse
avoir des sentiments à l’égard d’une Noire, c’est bien là le point de
basculement.
Si la réaction
de jalousie de Blanche est compréhensible, elle franchit à son tour une limite
inadmissible en forçant Mede à coucher avec elle. Cette combinaison d’actes
dans une société structurée par un racisme aussi violent provoque de façon
inéluctable l’explosion de la situation.
Et
lorsqu’Hammond comprend que ce sont ses sentiments pour Ellen qui sont la cause
de tout, mélangeant la jalousie avec ses conceptions patriarcales et le racisme
sous-jacent, il bascule complètement du côté du père et devient
impitoyable : il empoisonne sa femme, rejette violemment Ellen et le
châtiment réservé à Mede est épouvantable. Mais il faudra ce châtiment pour
qu’Agamemnon passe à l’acte et prenne les armes.
On a donc un
ensemble de relations complexes progressivement tissées qui explosent en fin de
film avec le basculement de Hammond, qui semblait pourtant avoir, au fond de
lui, cette empathie et cette considération que son père inflexible n’a jamais
eues. Hammond aurait pu signifier un premier pas vers le respect des Noirs
(notamment au travers de ses sentiments pour Ellen). Mais qu'un Blanc – et c'est là le terrible constat du film – puisse avoir des sentiments pour une Noire apparaît une relation « contre-nature » en quelque sorte : contre la nature de la société raciste du Sud. Tous les sentiments et toute l'empathie d'Hammond sont alors balayés : Ellen est rejetée et Mede est torturé.
Le film évoque aussi l’éveil d’une conscience de révolte chez les Noirs. Mais le carcan punitif reste serré (l’esclave qui lit ou écrit est violemment battu et Cicéron, qui est puni pour avoir déclenché une révolte, harangue – en vain – ses compagnons au moment d’être lynché). Mais si le père est inflexible sur ces points, Hammond semble lui plus réticent à punir (Agamemnon n’est battu qu’à contre cœur). Le film s’achève d’ailleurs par le réveil d’Agamemnon, qui reste longtemps observateur (malgré la phrase qu’il lance à Mede après son combat gagné – « tue encore quelques Noirs et ta peau va blanchir ») mais agit au dernier moment, en refusant de voir Mede puni injustement et si violemment.
Le film évoque aussi l’éveil d’une conscience de révolte chez les Noirs. Mais le carcan punitif reste serré (l’esclave qui lit ou écrit est violemment battu et Cicéron, qui est puni pour avoir déclenché une révolte, harangue – en vain – ses compagnons au moment d’être lynché). Mais si le père est inflexible sur ces points, Hammond semble lui plus réticent à punir (Agamemnon n’est battu qu’à contre cœur). Le film s’achève d’ailleurs par le réveil d’Agamemnon, qui reste longtemps observateur (malgré la phrase qu’il lance à Mede après son combat gagné – « tue encore quelques Noirs et ta peau va blanchir ») mais agit au dernier moment, en refusant de voir Mede puni injustement et si violemment.
Le film s’achève
donc sur un constat terrible du fils qui aurait pu, peut-être, basculer vers la
cause noire (il aime Ellen) mais qui, finalement, développe une haine féroce.
Réquisitoire
très violent – mais très riche – Mandingo
regorge de scènes qui sont autant de chocs, alliant la violence physique et
sexuelle avec la perversion ou la dépravation morale (de ce fait le film fut
violemment attaqué à sa sortie, allant jusqu’à être taxé de raciste !), avec un
climax final terrifiant. On reste sidéré qu’un tel film, aussi violent et aussi
à charge, ait pu bénéficier d’un large réseau de production et de distribution.
Le film sert de matrice à beaucoup de films sur le sujet qui le suivront, par exemple Django Unchained de Tarantino, mais celui-ci, s’il reprend directement plusieurs personnages ou plusieurs scènes, n’en reprend guère la complexité.