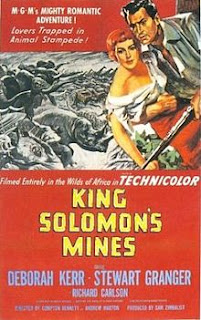Film remarquable et
iconoclaste dans l’approche des thèmes traités. Louis Malle choisit un personnage principal guère sympathique, qui est rustre, peu intelligent, sans culture : comme il erre sans but et sans idée, il se raccroche à ce qu'il trouve et parvient à en tirer profit. La collaboration, alors, lui donne ce que le maquis lui a refusé : une considération, une importance, de beaux habits, de l'action, des passe-droits. Tout ce que l'on veut sauf, bien sûr, une conviction profonde ou un quelconque antisémistisme. Mais cela lui va très bien. Il en vient alors à trahir des proches (l'instituteur, qui sera bientôt torturé) sans se rendre compte.
En pleine seconde guerre, suivre ainsi la destinée d'un collabo est une vraie réussite et pousse à penser cette période beaucoup plus puissamment qu’en suivant des résistants. La différence (montrée ici comme terriblement ténue) entre le résistant et le collabo est d'ailleurs explorée (on pense aux premières séquences d’Une vie difficile) : Lucien voulait être résistant, il sera collabo, voilà tout.
Lacombe Lucien est ainsi un des grands films qui traite de résistance ou de collaboration, période qui n'est pas souvent bien traitée par le cinéma. Si l'on pense bien sûr à L'Armée des ombres ou encore à Un homme de trop, ce sont souvent des films moins pertinents ou assez caricaturaux qui sont réalisés. Bien loin du propos complexe et dérangeant de Lacombe Lucien.