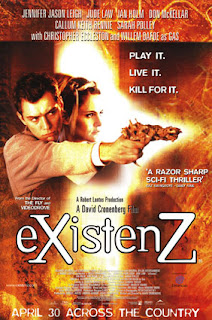Il faut bien dire à quel point Cronenberg, par essence (1), doit montrer les choses, les fixer avec sa caméra pour les mettre au milieu du cadre. Charge à lui, ensuite, de distiller le doute dans l’esprit du spectateur (s’agit-il de la réalité ou d’illusions, d’une horreur vécue ou d’un cauchemar ?). Mais, dans tous les cas, la monstration est au cœur de son cinéma. Avec Vidéodrome, il continue sur sa lancée et l’on voit Max engloutir sa tête dans une télé, Max au ventre déchiré d’une fente verticale farfouiller dans ses intestins, où une cassette vidéo être glissée par cette même fente, comme dans un magnétoscope. Le délire fusionnel joue à plein et Cronenberg peut exposer ses idées de nouvelle chair (« the new flesh »).
James Wood est parfait dans ce directeur d’une chaîne de télévision qui cherche toujours plus loin comment appâter ses téléspectateurs et qui plonge peu à peu dans la folie.
La fin impeccable, boucle la boucle et le spectateur en ressort sonné.