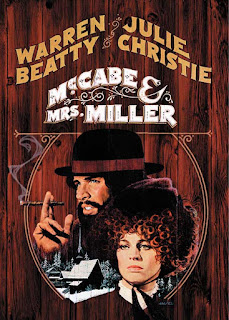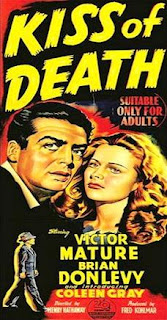Très bonne trilogie de C. Nolan, qui montre
ici tout son talent. Il parvient à faire sien ce héros tragique qu'est Batman
au travers de 3 films solides, confiants, rythmés et prenants.
Ces trois films proposent un double regard
intéressant puisque c’est tout à la fois le destin d’une ville et celui
d’un homme que le spectateur peut suivre. Sont donc explorés d’une part la réussite
économique et sociale ainsi que les bas-fonds de Gotham city et, d’autre part, l'incertitude
et le doute de Bruce Wayne opposés à l'apparence monolithique de Batman.
Très bonne distribution dans
les rôles principaux : Christian Bale est parfait, et, selon les épisodes, le
rôle du méchant est très réussi, qu’il s’agisse de Liam Neeson, Heth Ledger ou Tom
Hardy. Gary Oldman semble un peu sous-utilisé (son personnage de policier
incorruptible demande bien peu de composition, il est capable de tenir des rôles
autrement plus aboutis). Nolan est par ailleurs fidèle à plusieurs bons acteurs
avec lesquels il a déjà tourné et qui parsèment la distribution (Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy). Une exception
toutefois : on a beaucoup glosé, à juste titre, sur la faiblesse du jeu de
Marion Cotillard dans le 3eme épisode.
Le premier épisode, reboot qui repart sur de
nouvelles bases, exploite très bien le questionnement intérieur de Bruce Wayne
qui se cherche tout au long de l’épisode – il sort de Gotham et parcourt le
monde – pour, progressivement, structurer ses intentions (il veut changer le monde à
lui tout seul) sous la forme de Batman. Dans la progression du héros, c’est l'épisode qui apporte le plus.
Le second épisode est très réussi, en
particulier du fait d’un Joker époustouflant. Batman choisit même de sauver l’espoir
de Gotham en prenant sur lui la responsabilité de meurtres commis par le
procureur Dent (transformé en Double-Face par la faute du Joker). Nolan est
très à l’aise et il orchestre ses séquences d’action de main de maître (la
séquence d’ouverture par exemple).
Enfin le troisième épisode, s’il reste très
réussi, n’apporte pas grand-chose. Certes il permet de réhabiliter Batman – ce qui
n’est guère une surprise – mais c’est à peu près tout. On trouve dans cet
épisode une très lointaine parenté avec Le
Conte de deux cités de Dickens, dans l’asservissement par la terreur
instituée par Bane, avec par exemple des tribunaux populaires expéditifs qui rappellent
la Terreur en France. Le seul point original est la trajectoire de Bruce
Wayne qui, de l’enfer où l’enverra Bane, se sacrifie et passe pour mort, avant de parvenir au paradis
(représenté, comme il se doit, par Florence). Cette dimension très symbolique est
bien vue (la traduction mot à mot du titre original est d’ailleurs « Le Chevalier noir s'élève»).
Il y a néanmoins dans ce troisième opus une
certaine redondance avec le précédent. Mais il faut dire aussi que, dans chaque
épisode, le méchant veut provoquer la déchéance de Gotham City. Cette
répétition, si elle est bien naturelle dans une BD périodique, devient un peu
forcée dans un triptyque. En effet le premier épisode montrait un
commencement, le deuxième est une sorte d’aboutissement. Le troisième n’est qu’une
variante du deuxième : c’est en cela qu’il déçoit un peu, malgré quelques
belles scènes de bravoure et l’ascension symbolique de Batman.
On le sait, Batman n’est pas au sens strict un
super-héros : il n’a pas de superpouvoirs (par contre il a des jouets
efficaces pour se battre). Dès lors le scénario n’a pas besoin d’inventer des
super-méchants : Batman se bat contre des organisations ou des humains
retors. Nolan pioche alors dans l’historique de la BD pour multiplier les
méchants affrontés par son héros : Ra’s al Ghul, Joker, Double-Face, Bane,
l’Epouvantail…. Or, Hitchcock l’a bien souvent expliqué, la valeur du
héros dépend de la valeur du méchant. C’est là que le deuxième opus de la saga
marque un point : Heath Ledger construit un Joker délirant et sardonique,
bourré des tics effrayants.
On remarquera que le Joker est très différent
de Ra’s al Ghul et de Bane. Il n’a pas
de plan bien conçu et fignolé pour abattre Gotham City : il attaque tous
azimuts, détruisant directement ou s’alliant à la mafia pour mieux l’utiliser.
 |
| Heath Ledger en Joker |