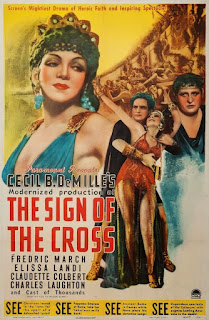Film remarquable
et surprenant de Peter Weir (1) qui commence comme un soap opera un peu niais, évoquant une quelconque série télé, avant
de se fissurer progressivement et de faire éclater en lambeaux le monde qu’il
présentait.
C’est que
Truman, tout à sa petite vie tranquille, fait en réalité l’objet d’un show à
son insu, avec les Dieux de la télé qui l’érigent en star. Non seulement il est
filmé, mais c’est toute sa vie et tout son monde qui sont des illusions (2).
The Truman Show, alors,
l’air de rien, aborde brillamment des questions fondamentales sur la vie en
société.
Le film propose d'abord, rapidement, une double dénonciation. D’une part celle, un peu facile, des médias,
de la télé-réalité et du jusqu’au-boutisme de la recherche d'audimat. D’autre
part celle d’un monde façonné de toutes pièces par des élites (représentées ici
par les producteurs de l’émission et autre directeurs de programmes) qui
construisent un monde faux pour de pauvres décérébrés consuméristes. Le but
étant, au choix, de les maintenir sous contrôle ou d’en faire de gentils petits
consommateurs bien dociles. On a là une critique assez simple de la société de
consommation.
Mais le film, au fur et à mesure que Truman prend conscience de ce qui se joue, aborde d’autres
questions, autrement plus fines.
La petite ville
de Seahaven, en n’étant pas la réalité mais simplement une illusion de la
réalité, est une belle image de l’allégorie de la caverne de Platon : la
ville – comme la caverne – maintient Truman dans l’illusion et, ce faisant,
dans l’ignorance. Sa volonté de s’échapper de la ville correspond alors à
l’homme qui quitte la caverne, s’échappe de l’ombre et cherche la lumière.
Il n’y a, dans
la petite ville, que des acteurs autour de Truman (3), chacun portant un masque
sauf Truman qui, lui, est sincère (d’ailleurs Christof le lui dit au moment où
il lui parle : « tout n’est pas
illusion, puisque tu es réel »). Dès lors Truman est un homme dans la
caverne, perdu parmi les ombres. C’est là qu’est la discordance, d’ailleurs,
lorsque Truman se rend compte qu’il est le seul sincère. La petite ville
devient aussitôt étouffante, avec l’artifice de l’illusion qui lui saute au
visage à chaque pas. Le film nous questionne alors : ne sommes-nous tous hors de la réalité, dans une société qui nous emprisonne, nous
empêche d’être éclairés ? Ou, pour le dire autrement : au sein de la
société, comment enlever son masque ?
La fin du film
(4) mène à une dernière question tout aussi cruciale : Truman ignore ce
qu’il trouvera en sortant du monde dans lequel il vit depuis toujours. Et le
film ne nous dit rien de sa vie future (sera-t-il plus heureux qu’au début
du film, quand il vivait dans l’illusion ?). Autrement dit le film évoque une
dernière interrogation : est-on prêt à payer le prix de la perte
d’illusion ? Est-on prêt à perdre le bonheur pour la vérité ? Préfère-t-on
le bonheur ou la vérité ?
L’hypothèse du
film est bien entendu que l’illusion du bonheur ne suffit pas : il faut,
pour être heureux, que l’on soit convaincu qu’il s’agisse d’une vérité. On ne
sait pas si Truman sera heureux dans le monde dans lequel il s’engouffre, mais
qu’importe, puisqu’il ne vivra plus dans une illusion. Ni la vérité, ni la
liberté ne garantissent rien.
Truman est salué
par les spectateurs : sa quête est vue comme noble et courageuse, son
action héroïque. Le film, alors, en nous identifiant à Truman, trace une route
à suivre : il nous montre que nous sommes réels – même dans une société
d’illusion – et il nous invite à lutter pour enlever notre masque et nous
libérer, comme le fait Truman. Cette libération n’amenant pas forcément au
bonheur, mais à la fin des illusions.
Si, par sa
dénonciation d’une americana un peu niaise et propre sur elle, le film évoque Edward aux mains d’argent, on retrouve
dans Matrix le même questionnement
décisif à propos du prix de la perte des illusions. C'est la question
symbolisée par la fameuse pilule rouge que Morpheus soumet à Neo.
________________________________
(1) : Peter
Weir dont il faut souligner la grande variété des films. On trouvera peu de
points communs, aussi bien en terme de sujet que de style, entre The Truman Show et Pique-nique à Hanging Rock par exemple, lui-même très différent du Cercle des poètes disparus.
(2) : On
peut trouver des prémices à ce scénario dans l'épisode de La Quatrième dimension « Un monde différent », qui évoque le mélange entre la réalité
et la scène, avec un acteur qui continue de l’être hors de la scène, ou
peut-être est-ce le contraire.
(3) : On
retrouve l’idée de Shakespeare (dans As
You Like It) : « Le monde entier
est une scène, hommes et femmes n’y sont que des acteurs, chacun fait ses
entrées, chacun fait ses sorties, et un homme, dans le cours de sa vie joue
plusieurs rôles ».
(4) : Le
moment où Truman s’échappe et que la tempête se déchaîne évoque le livre de
Job. La dimension divine de Christof devient alors particulièrement nette.