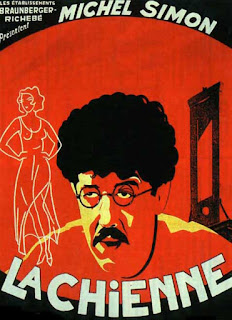Pour
ce qui sera son dernier film, Jean Renoir revient sur le film de guerre. Mais si Le Caporal épinglé reprend des
questionnements de La Grande illusion, le regard de Renoir y est très différent.
Pour son dernier film, Renoir ne fait plus appel à des acteurs stars ou immensément reconnus (La Grande illusion consacrait Gabin, Fresnay, Stroheim, Carette, Dalio, etc.) mais à des petits nouveaux (Jean-Pierre Cassel, Claude Brasseur, Claude Rich, Jean Carmet) qui sont tous parfaits (on regrette malgré tout le personnage de benêt bègue surjoué par Guy Bedos).
En
déplaçant l’intrigue de la première à la seconde guerre mondiale, c’est une
autre perception de son pays que filme Renoir. En effet il n’y a plus, ici, la
moindre trace de patriotisme : la France a disparu des radars, seuls
restent des individus qui se débattent comme ils peuvent, mais jamais pour leur
pays ou pour sauver ce qui peut l’être. Caporal le dit bien (« c’est à nous de nous démerder tout
seul ») et Ballochet fait ses petits arrangements sans autre
préoccupation que son petit confort. Il y a bien quelques petites magouilles
entre soldats, mais il n’y a nulle idée de collectif dans ces camps de
prisonniers : la France est battue, les soldats sont perdus. En filmant
cet élan national brisé, Renoir marque l’écart avec la situation des
prisonniers de La Grande illusion
qui, par exemple, apprenant la reprise de Douaumont, interrompent leur petit
théâtre pour chanter la Marseillaise. De même, l’inutilité de la mort de
Ballochet (qui se jette dans une évasion suicide sans illusion) contraste avec
le célèbre sacrifice du capitaine de Boëldieu.
Le
film suit alors les tentatives répétées et incessantes du Caporal pour s’évader
(mais, s’il veut s’évader ce n’est pas pour reprendre le combat ou rejoindre la
résistance, simplement il n’en peut plus d’être enfermé).
Renoir
construit son film autour du même axe que La
Grande illusion, à savoir le jeu entre les classes sociales qui se
mélangent parmi les prisonniers et entre prisonniers et gardiens. Mais les
choses changent : ce ne sont plus les aristocrates qui se retrouvent (de
Boëldieu et von Rauffenstein qui fraternisent) mais le petit peuple (les deux
adjudants qui se plaignent des tire-au-flanc). Et, on l’a dit, ce n’est plus de
Boëldieu qui se sacrifie pour permettre à ses compagnons de s’évader mais
l’intellectuel Ballochet qui se lance en solitaire dans une évasion-suicide. Et
les classes sociales se mélangent davantage : Caporal et Papa, l’un
bourgeois et l’autre homme du peuple, ne se quittent pas et s’enfuient
ensemble. L'amitié de Papa qui reste collé aux basques de Caporal (« Ma terre à moi
c’est là où est mon copain ») contraste avec la distance qui restera
toujours entre Maréchal, l’homme du peuple, et de Boëldieu, l’aristocrate.
Le
film marque une dernière fois la disparition de toute idée de patriotisme
lorsque Caporal et Papa, qui parviennent jusqu’à la frontière, croisent la
route de ce Français installé à deux pas de la France mais qui n’aspire pas à y
rentrer : il se sent chez lui ici, au lieu d’être exploité sur les terres
des autres en France. Là aussi le film creuse l’écart avec La Grande illusion, dans lequel Maréchal quittait Elsa pour rentrer
au pays.
En
plus de quelques jeux cinématographiques qui émaillent le film (par exemple le
montage alterné entre le défilé allemand et le déplacement des
prisonniers français), le coup de patte de Renoir transparaît dans le
traitement chaleureux de ces hommes et dans cette multiplicité de
petits portraits et de petites situations et cette amitié qui est toujours merveilleusement filmée.
Et,
en revenant une dernière fois sur l’amitié qui traverse les classes sociales
(avec Caporal qui promet à Papa, alors qu’ils viennent de rentrer à Paris,
qu’ils vont se revoir très vite, à la grande surprise de Papa), Renoir choisit
une fin résolument optimiste.