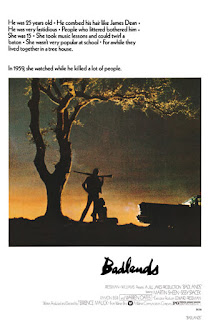Très beau film de Terrence Malick qui, prenant appui sur
la fondation de la première colonie anglaise à Jamestown en 1607, raconte la
rencontre de deux civilisations : celle des Anglais, arrivant en bateaux,
avec leurs armes et leurs intentions de conquête et celle des Indiens, qui sont
en communion avec la Nature. Il y a donc un choc entre cette Nature vierge, qui
est présentée comme un Paradis, et la civilisation, qui tente de s’installer
sur le rivage. Mais il y a aussi un choc entre une culture individualiste
(querelle de pouvoir notamment dans le fort) et l’harmonie collective des
Indiens, qui est manifeste dans les longues séquences pendant lesquelles John
Smith est retenu dans le village. Le
Nouveau Monde oppose ainsi une civilisation mortifère qui a tout rasé pour
s’installer, à une civilisation libre de ses mouvements vivant en harmonie avec
la Nature.
On remarquera le
souci de réalisme de Malick : le tournage a eu lieu en Virginie, sur le lieu même de l’emplacement
du premier fort, qui a été reconstruit avec les matériaux trouvés sur place. Les
chefs de différentes tribus ont participé et jusqu’à des experts en langue Alqonquin
pour traduire de larges portions des dialogues du script et pour l’apprendre aux
acteurs incarnant des Indiens. De même, des résultats de fouilles (pour connaître la forme des
maisons des Indiens) ont été utilisées ou encore un champ a été planté avec des
graines se rapprochant le plus possible du maïs de l’époque.
Le film reprend
à son compte l’histoire de John Smith, chef provisoire du fort précaire
installé sur la côte, et de l’indienne Pocahontas, qui s’interposera en faveur
du capitaine. La bienveillance de Pocahontas permettra aux hommes du fort de
survivre en dépit des difficultés rencontrées (le fort est bâti sur des terres
marécageuses insalubres, les cultures sont un échec, la nourriture se fait
rare).
Mais Malick
innove dans sa manière de raconter l’histoire. Avant même la rencontre
effective, le spectateur vit l’intrusion des colons du point de vue des
Indiens. Leurs déplacements sur les bords du fleuve accompagnent l’apparition
des caravelles. Il ne centre pas son récit sur John Smith et ses hommes, ni
même sur les difficultés d’installation des colons durant les premiers mois. Là
n’est pas ce qui l’intéresse. C’est bien plus une vision personnelle de la
Nature qui l’attire dans ce film.
En
effet, comme dans tous ses films, Malick situe son histoire au sein d’une
Nature qui enveloppe les hommes. Il n’oppose pas l’Homme et la Nature, mais il
montre l’intégration de l’Homme dans une Nature indépassable. A ce titre la
magnifique séquence d’ouverture (les caravelles glissant dans l’embouchure du
fleuve) est exemplaire, avec ce ton lyrique et symphonique qui s’étend sur
le film.

Et, ensuite, tout au long du film, Malick filme comme s’il ne prenait
non pas le point de vue des hommes, mais, en le décalant légèrement, celui de
la Nature. Les évènements eux-mêmes (le débarquement des colons, leur
installation, la rencontre avec les Indiens, etc.) semblent ainsi passer au
second plan. Et c’est la contemplation et la rêverie qui passent au premier
plan. La bande originale très lyrique, les voix off (procédé typique de Malick)
sont autant de moyens de prendre une distance avec l’action du film et les
personnages. Cette manière de faire permet d’ailleurs de découvrir les
personnages (Pocahontas et le capitaine Smith notamment) d’abord intérieurement
plutôt que par leurs actions.
Le
génie propre de Malick explose dans de longues séquences sans paroles, aux
images somptueuses, au montage fluide, au rythme libre et très changeant, à la
musique envoûtante, qui participent à la narration (cette manière de raconter
sans parole est aujourd’hui très rare). Cette beauté formelle détourne le
spectateur du récit lui-même et le conduit à ressentir cette bonté de la
Nature, redécouverte par John Smith en débarquant, mais aussi par Pocahontas,
qui, elle aussi, débarquera dans un nouveau monde, l’Angleterre, dans les
jardins civilisés de Londres. Le récit dépasse alors la simple histoire pour prendre
des allures de parabole et tendre à l’universalisme. C’est alors que l’on
ressent pleinement l’inspiration transcendantaliste de l’univers de Malick,
proche des poètes Emerson ou Whitman et de la philosophie de H. D. Thoreau
(axée sur la bonté de la Nature et sur une harmonie entre l’Homme et la
Nature). Malick n’expose pas ses idées au travers d’un personnage, mais il les
exprime par les images, toujours, et par les sensations qu’il fait naître chez
le spectateur. C’est en cela – en cette capacité à s’exprimer d’abord et avant
tout par les sensations visuelles et sonores – que Malick est un créateur
d’images.