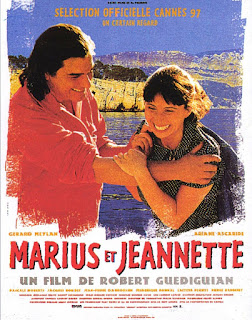Le film est une biographie,
c’est aussi un film d'époque : Lynch reconstitue en studio le Londres de
la fin du XIXe siècle, qui est alors en pleine révolution industrielle. Lynch,
formidable créateur d’images, créé une atmosphère prenante, lugubre par
moments, éblouissante à d'autres, et qui reflète la vision qu'il a de cette
époque. Son film abonde en éléments qui plongent le spectateur dans le passé et
dans une autre époque : au-delà de la reconstitution des lieux (l'hôpital,
le théâtre, les rues moites et malfamées), des costumes ou des pratiques de
cette époque (l'opération sans anesthésie par exemple), Lynch intègre des
multiples allusions, aussi bien des images (des surimpressions de machines ou de
fumées, des promenades en longs travellings à travers les rues) que des sons
(des bruits de machines, le crépitement de lampadaires à gaz, etc.).
Mais Lynch ne s’arrête pas à
cette reconstitution d’une atmosphère, il parsème son histoire d'autres images et
d'autres sons qui donnent un aspect fantastique et troublant au film. Il joue avec
les mouvements de caméra, des jeux d'ombres et de
lumières (lors de la présentation d'Elephant man aux médecins par exemple), des
images oniriques qui se superposent (images d'éléphants,
de regards de femmes, de fumées, etc.), des sons (des barrissements, des halètements…). Tout cela crée une atmosphère étrange,
onirique, très lynchienne, qui absorbe le spectateur.
Lynch nous interroge ici sur
ce qu’est un monstre, sur le regard que la société lui porte. C’est la question
classique de l’opposition apparence/personnalité mais portée à sa puissante la
plus forte : en nous soumettant à la vision d’un personnage difforme, il
propose une réflexion sur la tolérance de la société.
Merrick est d'abord présenté
comme un objet : il est exhibé par son propriétaire, qui le présente comme un
monstre de foire – le parallèle est annoncé d’emblée avec Freaks –, et qui tire profit de ce spectacle. Il est exhibé ensuite
par le médecin, devant un parterre d’autres médecins. Mais Lynch présente cet
exposé médical comme un spectacle comparable : un présentateur avec sa
baguette, un discours venant appuyer la « monstration », des rideaux
qui dissimulent d'abord, puis dévoilent, puis cachent à nouveau. Dans les deux
cas Merrick est regardé comme un objet (de fascination, de divertissement, de
profit, d'intérêt scientifique). Ce n'est que progressivement que Merrick
devient une personne : d'abord quand il parvient à convaincre le médecin
qu'il est intelligent et sensible, ensuite en apprenant les manières d'être qui
lui permettent d'être accepté par la bonne société anglaise.
La présentation du monstre est à ce
titre exemplaire. Lynch invite donc le spectateur à changer de regard sur le
monstre qui lui est présenté. Le spectateur est préparé d'abord en ne se voyant
dévoiler que très progressivement l’aspect de Merrick. Les trois premières
rencontres avec le monstre (à la fête foraine, lorsqu'il arrive à l’hôpital
puis lorsqu'il est présenté aux médecins) laissent le spectateur
insatisfait ; en effet on ne fait que l'entre-apercevoir. En revanche on
voit des gens qui l'ont vu : dès lors le spectateur s'identifie à ceux qui
l'ont vu et scrute leurs réactions. Lynch montre donc d’abord ce que provoque
la vision du monstre, si bien que le spectateur est réduit à mesurer son degré
de monstruosité à l’aune des réactions épouvantées ou atterrées des personnages
qui peuvent le voir.
Les hurlements de l'infirmière qui
découvre le visage de Merrick nous font découvrir la réalité que vit Merrick :
il est terrorisé. À ce moment se produit une inversion par rapport à l'image
commune du monstre : d'ordinaire un monstre fait peur, certes, mais il ne
ressent pas la peur. Ici on découvre qu’il a peur du
regard effrayé de ceux qui le voient. Et nous avons peur, alors, du regard effrayé de ceux qui le voient.
Ensuite le spectateur va s’attacher à
Merrick en même temps que le médecin, et on va découvrir qui il est : on
va cesser de le voir comme une chose, comme un objet, et, en dépassant
l’apparence de Merrick, on peut alors le découvrir comme une personne.
La fin tragique est
cependant pessimiste : en faisant mourir Merrick, Lynch indique peut-être
que la société ne peut accueillir en son sein des personnes trop différentes.
Ce qui est monstrueux, nous dit Lynch, ce
n'est donc pas l'homme-éléphant (seule son apparence est monstrueuse), c'est la
façon dont les hommes le traitent, la façon dont ils le regardent. Ce thème n’est
bien évidemment pas nouveau, Freaks l’avait
traité de façon éblouissante et crue (trop éblouissante et trop crue même peut-être). Sur un mode comique (et très réussi)
Monstres & Cie reprend l’inversion mise en avant dans Elephant man en
jouant avec des monstres terrorisés par des enfants.