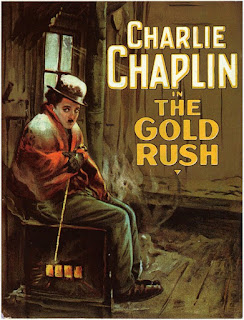Exceptionnel western, un des plus aboutis, des plus exotiques, des plus parfaits. Anthony Mann
reprend James Stewart comme interprète principal, s’entoure de solides seconds
rôles et déroule un récit foisonnant, riche, complexe, qui emmène très loin les
réflexions sur les valeurs américaines.
Un des intérêts du film
est que le personnage principal, Jeff Webster, n’a à peu près aucune des qualités
des héros conventionnels du western : il est certes courageux, mais il est
furieusement individualiste (et même égocentrique), il se désintéresse
complètement de la communauté et on sent un lourd passé derrière lui. Et c’est
l’évolution de ce personnage qui est fascinant dans ce film, au fur et à mesure
de son itinéraire. Son parcours le conduit à croiser un vieil homme, Ben, avec lequel, malgré
sa misanthropie, il se lie d’amitié, mais aussi plusieurs femmes qui iront jusqu’à se
sacrifier pour lui et jusqu'au marshal Gannon qui incarne, à sa façon et à son avantage, la loi. C’est ainsi que Mann, malgré la figure têtue et égoïste de
Jeff, fait vivre une communauté sous nos yeux, truculente et picaresque,
riche de mille détails, de mille « gueules » du cinéma ; communauté qui, forcément, entraînera Jeff à interagir avec elle.
 |
| Jack Elam, John McIntire et James Stewart |
La splendeur plastique
du western est fidèle à A. Mann qui nous entraîne aux confins des régions
civilisées, à travers des fleuves, des glaciers, des étendues grises où règnent
les loups.
J. Lourcelles, dans son Dictionnaire du cinéma, en fait un
commentaire long et remarquable. Il explique comment, dans le film, se mêlent
plusieurs histoires :
« Une histoire individuelle, celle du héros,
incarné par James Stewart dont le passé lourd de secrets, le rapport à la
violence, la solitude, et une sorte de sauvagerie volontaire prolongent une
méditation sur ces thèmes, menée de longue main par l’auteur. Une histoire
collective où une bande de chercheurs d’or et de citoyens ordinaires veulent
fonder une vraie ville, appuyée sur des valeurs universelles et sur des
institutions séculaires. La rencontre, l’entrelacement, la fusion de ces deux
histoires en suscitent une troisième, qui est l’essentiel du film. Au cours d’un
itinéraire rectiligne et passionnant, Jeff Webster (James Stewart) découvre
chez lui un sens des responsabilités, une solidarité avec certains de ses
semblables, notions que jusqu’à présent il avait fuies. Il fait cette
découverte avec surprise, presque à regret, à la fin du récit avec un début d’acquiescement.
[…] A travers ce personnage, Anthony Mann exprime la nécessité d’unir
pragmatisme et morale. Et c’est paradoxalement parce qu’il était un pragmatisme
imparfait que Jeff a compris la nécessité absolue de la morale. Après tout, s’il
ne s’était pas embarrassé du vieux Ben, s’il n’avait aucun ami, son plan aurait
réussi. Autre originalité : c’est le thème de la vengeance (où réapparait
l’habituelle obstination des héros d’Anthony Mann) qui introduit ici le thème
de la solidarité. »
Il est fascinant de
constater à quel point le western, genre pourtant en apparence très conventionnel, bourré de codes, qui a
parfois des relents enfantins (« les cowboys contre les Indiens »),
est devenu capable de s’enrichir jusqu’à proposer des réflexions vastes et
poussées sur la société ou les individus et la place respective de l’un ou
l’autre, tout en se mariant à un récit d’aventures exceptionnel et foisonnant. Peu de films sont aussi complexes, et amènent
autant de réflexions.
On ne peut que regretter,
alors, la lente agonie que subira le genre, à partir des années 60, genre à la
fois vidé de sa substance (par le western italien) puis progressivement enterré (par les
westerns du Nouvel Hollywood, qui abordent de plein fouet les non-dits de l'histoire de l'Amérique) avant de ne vivoter qu'au travers d'une production maigrichonne. Il ne se fait plus guère de grands westerns, le genre est devenu presque réservé à une élite de cinéphiles (encore que le retour de Tarantino dans le genre lui soit bénéfique) et un film comme Impitoyable apparaît alors pour ce
qu’il est : une exception à cette triste règle.