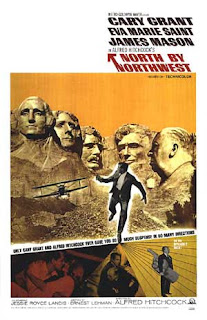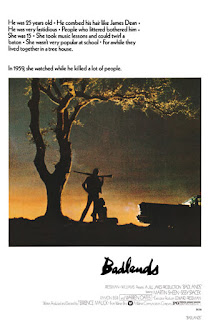Le dernier film de Quentin Tarantino est très décevant. Alors bien sûr Tarantino est un très bon
réalisateur : il joue avec sa caméra tout en jubilant derrière l’objectif.
Comme à son habitude il fait dialoguer à tout va, en contre-point des
explosions de violence et joue avec les références cinéphiles.
Le problème principal,
déjà entrevu, est qu’il se caricature lui-même. On pourrait se dire qu’il ne se
caricature pas mais qu’il épure son style (un peu comme Melville a épuré son
style, depuis Bob le flambeur ou Le Doulos pour arriver au Samouraï par exemple). Mais il se trouve
que le style brillant de Tarantino est déjà une caricature et, même, la
caricature d’une caricature. En effet il explore la fenêtre stylistique ouverte
par Sergio Leone (même si Tarantino multiplie les références et les gimmicks,
l’inspiration stylistique majeure est celle du maître italien). Or Sergio Leone est un
maniériste : il a repris les principaux thèmes du western et les a
exagérés et stylisés (ce faisant Leone a abandonné toute espèce de réflexion de
fond pour s’en tenir à la forme). Tarantino refait le même coup : il
stylise à l’extrême. Le voilà donc qui caricature Leone qui caricaturait les
réalisateurs classiques. Et, maintenant, Tarantino se caricature. Ça commence à
faire beaucoup ! On comprend alors pourquoi il tourne en rond et ne se
renouvelle pas.
En effet Les Huit salopards pousse à l’extrême
cette tendance. C’est un western à huis clos (la première partie est en
extérieur mais avec déjà l’enfermement dans une diligence) avec des
personnages qui, comme il se doit, passent beaucoup de temps à parler, et qui
s’entretuent en des explosions de violence soudaines, barbouillantes de sang.
Il y a un certain retour
aux sources (en arrière ?) pour Tarantino à revenir au western, à
abandonner ce qu’il avait tenté de faire dans les films précédents (ce qui
n’est pas forcément un mal, j’y reviendrai) et à offrir ce mélange (dont il
sait le public friand) d’attente et de violence. Le film est d’ailleurs long et
assez lent : il nous rappelle que Tarantino ne fait pas des films
d’action, mais d’abord des films violents.
Les acteurs jouent des
rôles qu’ils connaissent bien. Le personnage joué par Samuel L. Jackson ressemble à
son personnage dans Pulp Fiction. Non
pas que les personnages soient similaires, mais Jackson les campe de la même
manière, avec le même ton sermonnaire. De même Kurt Russel semble condamné à jouer des personnages caricaturaux,
qu’il soit dirigé par Carpenter ou Tarantino. Ou encore Tim Roth dont le
personnage s’inspire terriblement de celui interprété par Christoph Waltz dans Django
unchained (là encore il ne s'agit pas du personnage lui-même mais du jeu de
l’acteur).
Tarantino continue de chapitrer comme il le fait si souvent, mais on est loin des récits entremêlés de Pulp Fiction. Ici nulle déstructuration du récit, nul jeu avec le temps qui avance, recule et se croise, il n'y a guère qu'un simple flash-back, qui n'intervient pas par volonté d'éclater le récit mais par simple souci scénaristique de préserver le suspense (même si parler de suspense est un peu exagéré).
L’histoire en elle-même
est infiniment secondaire (et l’intrigue, en fait, extrêmement simple). C’est
intéressant de voir que Tarantino fait parler ses personnages (c’est rien de le
dire) mais qu’il n’en ressort rien : il s’agit simplement de raconter leur
histoire, mais sans parvenir à les épaissir. En effet, quand on les voit
évoluer sous nos yeux, ils expliquent
pourquoi ils en sont là (untel explique pourquoi il vient se venger ou pourquoi
il vient sauver un autre, etc.), mais ils ne sont pas transformés par les
expériences qu’ils vivent dans le film : ils restent identiques à ce qu’ils étaient
à la première minute où on les a vus. C’est pour cela qu’ils sont souvent
proches de caricatures et que, malgré tous leurs bavardages, ils restent vides.
On sait par exemple que de banales histoires de vengeance (comme ici) peuvent devenir de
véritables réflexions. On pense à L’Homme de la plaine, par exemple, où Lockhart vient pour se venger. Mais les
choses ne sont pas si simples : les péripéties font douter et hésiter Lockhart, il revient en arrière, puis se raffermit de nouveau. Mais ici Tarantino,
comme Leone, abandonne la substance pour le style.
C’est ainsi que, si
Tarantino est génial avec sa caméra, il n’a pas grand-chose à dire.
Alors, bien sûr, la renommée
incroyable de Tarantino incite à se questionner : il y a forcément plus
qu’une caméra, il y a forcément une idée derrière. D’autant plus que, le temps
de deux films (Les Huit salopards
marque en cela un retour en arrière), Tarantino n’a plus cherché simplement à
s’amuser derrière sa caméra pour nous distraire, mais il a aussi voulu faire
passer un message, faire presque un film à thèse. Jusqu’à Kill Bill : volume 2 la narration s’embarrassait
peu d’un script compliqué, mais ensuite (avec Inglourious Bastards et Django Unchained)
Tarantino s’est mué en redresseur de torts et a flatté son public (aux USA le
succès de Django doit beaucoup à
cette idée d’un noir gunfighter qui vient régler son comptes aux
esclavagistes).
Et ainsi, à bien y
regarder, on peut peut-être chercher une signification générale dans les films
de Tarantino. C’est peut-être l’idée que le cinéma peut tout : dans Kill Bill : volume 1 l’héroïne est
insubmersible (elle ne l’est plus du tout dans la seconde partie du diptyque),
dans Inglourious Basterds ou Django Unchained c’est l’Histoire elle-même qui
est remodelée par le cinéma (au sens strict même dans le premier cité : la
pellicule enflammée vient brûler Hitler et ses sbires). Mais malgré tout
c’est bien peu de choses, il n’y a guère lieu de crier au génie, tout cela
reste très basique. En fait, pour le dire autrement : Tarantino n’a rien à
dire mais qu’est-ce qu’il le dit bien !
Mais enfin, on pourrait toujours
aborder ce film simplement et ne pas bouder son plaisir. Deux éléments viennent
pourtant brider le plaisir.
Le premier élément est
que le film est un western. Là où dans Kill
Bill : volume 1 Tarantino transposait son style dans le monde contemporain et
se libérait ainsi partiellement du style originel de Leone en variant les
situations, le voilà qui choisit de revenir au western où cette originalité de
transposition disparaît. Dans Les Huit salopards on se croirait vraiment dans l’auberge d’Il était une fois dans l’Ouest, quand
Cheyenne y fait irruption les menottes au poignet. Ça sent beaucoup trop le
réchauffé.
Le deuxième élément est
qu’il faut partager les goûts de Tarantino pour jubiler devant ses films. Or
ses goûts sont notamment la culture pop, les séries télé, les références aux séries B
violentes et aux mangas. Et, bien entendu, les éclaboussements de sang, les
gerbes de sang, les vomissements de sang et toutes ces références au gore (une
oreille coupée dans Reservoir Dogs,
des clous plantés dans la tête ou le pied ou un crâne en partie tranché dans Kill Bill : volume 1, des scarifications dans
Inglourious Basterds, bien des chairs
déchiquetées dans Django Unchained, des gerbes
de sang vomies ou des têtes explosées dans Les
Huit salopards…), gore qui, je n’en doute pas, l’amuse beaucoup. Chacun ses goûts, bien entendu, mais tout cela ne procure pas le même plaisir si on ne goûte qu’à demi ces gerbes de sang, quand bien même on en comprend l’ironie ou
l’exagération. On peut aimer voir une tête exploser et le sang gicler, on peut aussi préférer un meurtre filmé par Hawks dans Scarface : Gaffney lance sa boule de bowling, la caméra la suit jusqu'aux quilles qui sont fauchées, une dernière quille tourne sur elle-même une seconde avant de tomber, le tout sur fond sonore de rafales de mitraillettes. Inutile d'en montrer davantage, on sait que Tony Camonte vient d'éliminer un rival.
Le principal danger qui
guette les films de Tarantino est d'ailleurs lié à ses goûts justement : c'est que très
vite ses films apparaissent datés. C’est déjà le cas pour Pulp Fiction : le film vieillit mal. Il est en effet tellement
incarné dans un moment, tellement dans l’air du temps de l'époque de sa création
que cela s’en ressent 20 ans plus tard.
Un mot aussi à propos des fameux dialogues chers à Tarantino. Je crois qu'il faut revoir comment certains chefs-d'oeuvre, par exemple chez Mankiewicz (dans Le
Limier ou Un américain bien tranquille), jouent des dialogues pour servir une narration ou déclencher des situations. Chez Tarantino ils sont de pure forme (c'est en cela qu'ils font partie de son style). Faire dialoguer pour passer le temps (ce qui est très réussi dans Pulp Fiction par exemple), pour être l'occasion de gimmicks ou de références à la culture pop, ce peut être intéressant, mais on peut aussi trouver cela un peu court. Certes il y a des séquences très dialoguées brillantes (dans Inglourious Basterds par exemple), mais sur l'ensemble des lignes de dialogues, les séquences bavardes restent le plus souvent bien loin de morceaux de bravoure.