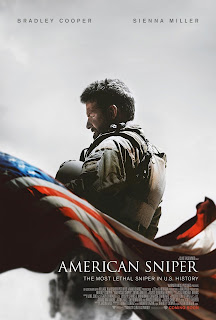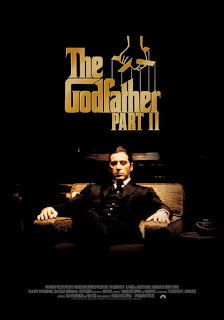Chef-d’œuvre éblouissant de maîtrise,
passionnant et inoubliable. Francis Ford Coppola nous abreuve en images qui marquent
immédiatement et les scènes légendaires affluent.
La séquence d’ouverture est à ce titre
exemplaire : elle annonce et résume le film tout à la fois. Coppola montre de façon alternée le mariage qui se déroule en
plein air, au milieu des chants, des danses, des rires. Mais, en même temps,
une toute autre cérémonie se déroule : dans le bureau fermé, dont l’accès
est filtré, le parrain assoit son autorité, on vient lui faire allégeance.
L'obscurité du bureau manifeste, par extension, l'illégalité de ce qui s'y
déroule. Coppola fait donc participer le spectateur à une fête et, en même
temps, le fait entrer dans les arcanes d’un pouvoir. Il
se crée une figure quasi-mythologique : celle d’un chef qui contrôle,
depuis l'obscurité de son bureau, une organisation immense et puissante, auquel
tout le monde rend des comptes. Cette dualité résume la famille
Corleone : elle veut apparaître joviale (une fête est donnée), respectable
(Don Corleone a des appuis parmi les hommes politiques, les juges, etc.) mais
il s’agit d’un pouvoir impitoyable. Tout cela est
exposé de façon limpide, claire et en même temps foisonnante, en introduisant
une multitude de personnages qui sont autant de rouages de la machine.
A l’autre extrémité du film, la séquence finale,
qui conjugue le baptême de la nièce et les règlements de compte qui assurent la
passation de pouvoir, est magistrale. Michael devient parrain dans tous les sens
du terme : religieux, familial et criminel.
Et la dernière scène du film reprend la première : on y
voit Michael recevoir un baisemain d’allégeance, exactement comme son père le
recevait. La porte du bureau se referme : le pouvoir s’y exerce de
nouveau, et l’on sait déjà comme Michael sera puissant et impitoyable.
Le film est évidemment porté
par des acteurs exceptionnels. On peut d'ailleurs supposer que Coppola s’est fait dépasser
par ses acteurs : les personnages sont tellement fascinants qu’on ne les
déteste pas autant que le prévoyait Coppola. Marlon Brando marque les esprits,
instaure une représentation désormais fixée du chef de famille : tout en
retenue, mais en laissant percevoir combien il est implacable et indifférent à
autrui dès lors qu’il n’est pas de la famille. Le magnétisme qu’il dégage est aujourd’hui encore intact.
Pourtant malgré Brando
et son personnage qui s’est inscrit dans les esprits, le personnage central est
bien Michael. Lui qui ne demandait qu’à se tenir à l’écart des affaires se voit contraint par les circonstances, progressivement, de prendre
la charge de la famille. Largement tenu à l’écart de la guerre des familles par
Sonny, Michael finira par accomplir son destin. C'est de loin le
meilleur rôle d'Al Pacino (l’acteur a, par ailleurs, une trop grande tendance à cabotiner).
La scène clef du film (et de l’histoire de la
famille Corleone) reste celle de l’hôpital où Michael, par son sang-froid,
sauve son père. Celui-ci pleure en découvrant ce qu’a fait son fils, mais ses
pleurs recouvrent tout à la fois la certitude d’avoir là son successeur et la
douleur de voir son fils plonger dans les affaires impitoyables de la
famille : Vito sait le destin qui attend son fils, bien avant Michael
lui-même. C’est là que la passation de pouvoir se fait. Ce n’est donc que progressivement que Michael s’endurcit,
prend la charge de la famille et la dirige, à contre-cœur, conscient des
renoncements que cela implique. Mais il ne peut échapper à son destin. Le
mensonge final à Kay en est le symbole : il n’a plus le choix, il est obligé de mentir à celle qu’il
aime (ce qui le condamne définitivement à être un homme seul), de la même façon qu’il doit punir les traîtres et tous ceux qui
s’opposent à la famille. Ce mensonge, violent et prononcé les yeux dans les yeux signe la conséquence immédiate de sa prise de pouvoir : désormais Michael est un homme seul. Là est son destin. Ce fut celui de son père, c'est ce qu'il voulait éviter à son fils. La solitude du pouvoir, de la décision, du poids des morts. Michael est (et sera encore dans la suite) filmé seul, adossé, fixé dans ses pensées.
Au-delà des deux rôles phares, toute la
distribution est parfaite. Coppola
est très jeune quand ce scénario lui est proposé, pourtant, il parvient à
imposer sa façon de voir aux producteurs : il impose Marlon Brando dans le
rôle principal et choisit Al Pacino dans le rôle clef de Michael (James Caan a tenu la corde dans un premier temps pour ce rôle mais il ne faisait pas assez italien – le Sonny qu’il interprétera est de toute façon légendaire).
Coppola décrit une mafia qui
pervertit les valeurs de la société américaine (sens de la religion, importance
de la famille, respect des traditions, fidélité à la parole donnée, admiration
pour les puissants qui ont réussi) pour les mettre au service de la
« famille », sans pitié pour toutes les personnes
extérieures à cette famille. En plus de la description d’un univers criminel, le regard sur la société américaine est donc virulente.
Le medium cinéma prend, aux Etats-Unis pendant le XXème siècle, une importance considérable. Après la poésie pendant l'Antiquité, la chanson de geste au Moyen Âge, le théâtre au XVIIème siècle ou le roman au XIXème siècle en France, c'est par lui que les mythes et légendes s'écrivent et s'inscrivent dans la mémoire collective.
On tient là, avec Le Parrain (en incluant son éblouissante suite), l'un des plus beaux exemples de cette dimension opératique, funèbre et lyrique et qui dessine, peu à peu, les contours d'une tragédie.
Le Parrain II est tout aussi passionnant. Coppola coupe et entremêle
son film en deux époques. L’une est un peu datée : c’est celle où l’on
voit Michael étendre son empire ; l’autre est hors du temps : les
scènes tournées sur l’enfance de Vito Corleone sont éblouissantes. La séquence
du meurtre de Fanucci, conduite en un double travelling est
exceptionnelle. R. De Niro compose un Don Corleone parfait, rôle d’autant
plus difficile que l’interprétation de M. Brando est ancrée dans toutes les
mémoires.
Il faut bien
entendu voir et comprendre les films
comme un diptyque (la troisième partie, pourtant réussie, ne vaut pas les deux premières).
On pourrait s’interroger : comment faire un
film sur ce thème après un tel chef-d’œuvre ? En fait Coppola a choisi
dans ses films de montrer la tête de la pieuvre (l’aristocratie de la mafia si l'on veut), avec le pouvoir qui s’exerce et les luttes de haut rang. Cela laisse
bien des possibilités : dans Les Affranchis ou Casino, M. Scorsese montre les caïds un cran en dessous, et dans Gomorra,
de M. Garrone, ou dans Mafioso de A. Lattuada (sorti avant Le Parrain)
ce sont les exécutants dont il est surtout question. Ce n’est alors plus la
tête de la pieuvre qui est scrutée, mais l’extrémité du tentacule.
On notera que,
pour les fans, le pèlerinage se fera en Sicile, dans le village de Savoca, à
quelques kilomètres de Taormine. On y trouvera, conservés en l'état, le bar
Vitelli, où Michael demande la main d'Apollonia à son père, et l'église du
village, sur le parvis duquel leur mariage est fêté.