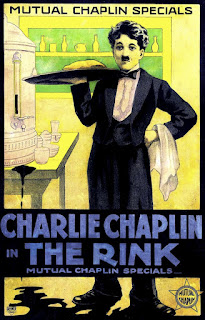S’il est pavé de
bonnes intentions, Écrire pour exister est un film trop conventionnel et empli
de bons sentiments pour convaincre, surtout avec une réalisation molle et convenue.
Le principal problème d’Écrire pour exister est que la trame du film a été vue et revue bien des fois et que, du coup, il ne réserve aucune surprise : la toute jeune professeur Erin (Hilary Swank) est parachutée dans une classe très difficile, où se côtoient différentes communautés liées à des gangs. À coup d’innovations pédagogiques, d’investissement personnel et d’un combat de tous les instants (contre sa hiérarchie notamment), elle parviendra à détourner ces ados de leur destin tout tracé. On a là un lointain avatar du professeur Keating mais inversé : l’iconoclaste Keating en venait à détourner de la chose scolaire des ados programmés pour réussir (c’est en tout cas ce qui lui est reproché in fine) quand Erin, au contraire, les accroche et les met dans le droit chemin.
Bien entendu la caricature n’est jamais loin : il n’y a qu’à voir les réactions outrées des autres professeurs devant les méthodes peu orthodoxes employées par Erin.
Le film, vantant l’école socialisante qui vient se suppléer aux défaillances familiales, respire alors une moraline sucrée et jouée d’avance : on se doute bien qu’Erin va amadouer sa bande d’affreux. Ce ne sont pas les digressions sur les vies terribles de tel ou tel jeune – à grand coup d’émotion – qui construisent un quelconque suspense : la réussite de la jeune professeur ne laisse rapidement guère de doute.
Enfin, quand bien même le film est l’adaptation d’une histoire vraie, la réalité pédagogique est aujourd’hui bien différente de celle décrite dans le film : l’ensemble des professeurs a aujourd’hui – en France tout du moins – des méthodes qui s’apparentent à celles de la jeune Erin et les quelques rares iconoclastes qui veulent, au contraire, un enseignement plus classique, plus transmissif ou plus vertical sont mis à l’index et passent pour de méchants élitistes qui n’ont rien compris à l’enseignement. L’exact opposé de ce que nous dit le film en somme.
Le principal problème d’Écrire pour exister est que la trame du film a été vue et revue bien des fois et que, du coup, il ne réserve aucune surprise : la toute jeune professeur Erin (Hilary Swank) est parachutée dans une classe très difficile, où se côtoient différentes communautés liées à des gangs. À coup d’innovations pédagogiques, d’investissement personnel et d’un combat de tous les instants (contre sa hiérarchie notamment), elle parviendra à détourner ces ados de leur destin tout tracé. On a là un lointain avatar du professeur Keating mais inversé : l’iconoclaste Keating en venait à détourner de la chose scolaire des ados programmés pour réussir (c’est en tout cas ce qui lui est reproché in fine) quand Erin, au contraire, les accroche et les met dans le droit chemin.
Bien entendu la caricature n’est jamais loin : il n’y a qu’à voir les réactions outrées des autres professeurs devant les méthodes peu orthodoxes employées par Erin.
Le film, vantant l’école socialisante qui vient se suppléer aux défaillances familiales, respire alors une moraline sucrée et jouée d’avance : on se doute bien qu’Erin va amadouer sa bande d’affreux. Ce ne sont pas les digressions sur les vies terribles de tel ou tel jeune – à grand coup d’émotion – qui construisent un quelconque suspense : la réussite de la jeune professeur ne laisse rapidement guère de doute.
Enfin, quand bien même le film est l’adaptation d’une histoire vraie, la réalité pédagogique est aujourd’hui bien différente de celle décrite dans le film : l’ensemble des professeurs a aujourd’hui – en France tout du moins – des méthodes qui s’apparentent à celles de la jeune Erin et les quelques rares iconoclastes qui veulent, au contraire, un enseignement plus classique, plus transmissif ou plus vertical sont mis à l’index et passent pour de méchants élitistes qui n’ont rien compris à l’enseignement. L’exact opposé de ce que nous dit le film en somme.