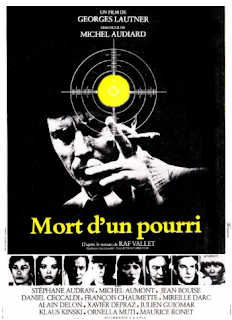Ridley Scott propose ici un film
intéressant et assez réussi, qui emmène son idée au bout, en faisant planer
longtemps une incertitude sur les faits qu’il raconte. Le réalisateur nous ayant
habitué, ces derniers temps, à des films tellement décevants et laborieux, on en est presque surpris.
Le Moyen-Âge est filmé avec des tons très sombres qui rejoignent l’imaginaire commun
d’une période correspondant à des temps obscurs, ce que vient contredire
l’image (fascinante), vue plusieurs fois en arrière-plan, de Notre-Dame en train d’être construite.
Le film est construit selon le
procédé développé dans le Rashōmon de
Kurosawa, où la même séquence est racontée successivement par différents
personnages, avec ce que cela suppose de variations et de contradictions (1).
Ici on a bien du mal à extirper le vrai du faux et – c’est bien là le but – à
savoir qui dit la vérité dans cette affaire. Et, dans cette histoire de
viol et de trahison, de façon assez curieuse – mais c’est là une curiosité qui
est une qualité –, aucun des deux personnages du duel à venir n’apparaît
sympathique. Ni Jean de Carrouges (Matt Damon), lourd et rustaud, ni Jacques le
Gris (Adam Driver), hypocrite intrigant. Ce choix du réalisateur freine
beaucoup l’identification du spectateur à l’un des deux, même si l’on prend, très progressivement, fait et cause pour l’intègre Carrouges, largement floué et moqué. Et c'est cette manière de faire qui permet d’emmener assez loin l’incertitude du dernier
duel du titre.
Mais, dans la dernière séquence
où le duel proprement dit est enfin mené, on regrette – sans être
surpris : on connaît Ridley Scott – qu’il soit l’occasion de tous les
passages obligés fatigants des réalisations modernes, à coups de travellings,
de ralentis fatigants et de musique pompeuse. L’affrontement s’étire
inutilement. La sécheresse d’un combat ferait tant de bien. Nous parlions de
Kurosawa : il est bien dommage que la leçon du duel final de Sanjuro soit aujourd’hui complètement oubliée.
________________________________
(1) : On notera que ce procédé,
s’il est célèbre depuis Kurosawa, est moins efficace que le jeu de
champ-contre-champ, tel qu’il apparaît dans Mademoiselle par
exemple, où la deuxième partie du film n’est pas l’interprétation d’un même
épisode mais son complément. Elle est ce qui manque à la première, comme deux
pièces de puzzle qui s’emboîtent.