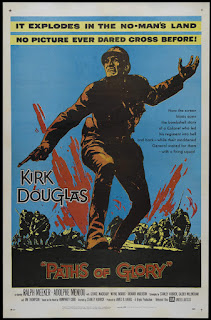Il faut bien avouer que ce fameux film de
Kubrick est très contestable. S'il est formellement éblouissant de maîtrise et si son impact visuel est très fort (beaucoup de séquences sont exceptionnelles : les
travellings dans les tranchées, l’attaque avortée, l’exécution…), il est
en revanche assez peu convaincant dans les sujets qu’il aborde.
L’objectif du film n’est pas de
dénoncer la guerre (la question n’est pas : la guerre est-elle
horrible ?), mais la question à laquelle cherche à répondre Kubrick est
plutôt : beaucoup de soldats meurent dans une guerre, mais pour quelle(s)
raison(s) ? La guerre justifie-t-elle une armée inhumaine ?
La première réponse proposée par le
film – et celle qui est traitée de façon très caricaturale – est l’absurdité de
l’armée : les ordres sont suicidaires, les fusillés pour l’exemple sont
choisis au hasard. Les généraux considèrent les soldats comme une masse ou
comme des effectifs, dont tel ou tel pourcentage de perte est admissible et
calculé. Les généraux n’aiment pas les soldats. La colline qui doit être
attaquée se nomme d’ailleurs « la Fourmilière » ce qui fait référence
aux fourmis qui se sacrifient pour leur colonie : les soldats sont donc
bien des insectes que l’on peut sacrifier en leur demandant un assaut
impossible.
Au contraire, le colonel Dax, héros
du film, refuse de parler d’une masse de soldats, il voit en eux des individus,
dont certains vont mourir. L’ennemi semble donc, non pas tant l’armée
allemande, qu’on ne voit jamais, mais plutôt les généraux, indifférents au sort
de leurs hommes. Cela apparaît d’autant plus clairement dans la scène où le
général demande de tirer sur ses propres hommes.
L’absurdité vient à la fois de
l’assaut, qui est inutile et vain, et des fusillés choisis au hasard qui sont
l’exemple suprême de l’injustice.
C’est sur ce premier point que l’argumentation
de Kubrick est très problématique : il raisonne à partir de cas exceptionnels : les fusillés pour l’exemple furent-ils si nombreux ? Quelques centaines, pour plus d’un million
de morts durant toute la guerre ; un officier qui demande à tirer sur ses
propres troupes ? Seuls quelques cas très rares ont pu être avérés. L’addition
de ces conditions très rares fait perdre tout poids à la thèse. Et la caricature
n’est pas loin entre l’officier proche de ses hommes et les officiers
supérieurs loin des combats et indifférents au sort des hommes.
Les autres thèmes sont plus
intéressants. Il y a d’abord celui du courage et de la lâcheté.
C’est en effet l’ordre donné par les
généraux d’attaquer une position imprenable qui est à l’origine de tant de
morts injustes dans le film. Le colonel Dax n’accepte pas le sacrifice inutile
de ses hommes pour servir les ambitions des généraux. Mais ces ordres ne sont
pas assumés : le général refuse de reconnaître qu’il a fait tirer sur ses
propres troupes ; l’ordre d’attaquer la Fourmilière n’est jamais reconnu
pour ce qu’il est (suicidaire, inutile) mais, au contraire, c’est la prétendue
lâcheté des soldats qui est mise en avant. La scène du procès le démontre.
Kubrick attaque donc le culte du
courage dans l’armée : on met en avant la virilité, le courage de faire
face à la mort pour mieux envoyer les soldats dans une attaque impossible. Les
fusillés, au-delà de l’injustice qui leur est faite, n’acceptent pas d’être
pris pour des lâches. Le culte du courage apparaît comme une idéologie
inculquée aux soldats pour mieux les manipuler.
Autre aspect du fonctionnement de l’armée
dénoncé par Kubrick : le sens du devoir. Kubrick s’attaque en effet à la
responsabilité dans l’armée, où chacun est lié par un commandement
suprême : celui d’obéir aux ordres. C’est le sens du devoir, fondamental
dans la hiérarchie militaire. Mais un terrible effet pervers apparaît : le
soldat se doit d’obéir à un ordre, peu importe son contenu. L’ordre reçu permet
ainsi au lieutenant qui a tué un de ses hommes lors de la reconnaissance
nocturne de se débarrasser d’un témoin gênant, tout en déguisant cet acte sous
la simple obéissance à un ordre. Ce sens du devoir engendre donc une culture de
l’irresponsabilité : « ce n’est pas de ma faute, ce sont les
ordres ! ».
Mais le corollaire de cette
irresponsabilité est qu’il faut toujours un responsable ! Comme le général
fuit sa responsabilité dans l’échec de l’offensive, elle retombe sur les
soldats et certains se font fusiller, car on considère que c’est de leur
faute, du fait de leur lâcheté.
Le colonel Dax vient donc s’opposer
à toutes ces dénonciations de Kubrick : il se soucie de ses hommes, il est
courageux, il ne fuit pas ses responsabilités, il a conscience des conséquences
des ordres auxquels il doit obéir.
Son destin, ici, est d’être écrasé
par la machinerie à l’œuvre dans l’armée : il ne parvient pas à empêcher
l’assaut, il ne parvient pas à sauver ses hommes, il ne veut pas rentrer dans
le jeu de l’armée (il refuse la promotion qui lui est proposée) et reste ainsi
en marge du pouvoir. Il continuera de subir l’injustice et l’absurdité de
l’armée.
La séquence finale est remarquable et
d’un ton très différent. Elle est quasiment unique dans la filmographie de
Kubrick : elle est emplie d’émotion alors que Kubrick est un réalisateur complètement
cérébral. Cette séquence donne raison au colonel Dax : l’émotion ressentie
par les soldats en entendant chanter une Allemande montre la sensibilité des
soldats et leur humanité. Ils ne sont pas des fourmis que l’on peut sacrifier
sans sourciller.
Le film n’est donc pas un film
contre la guerre, mais contre l’armée. D’ailleurs (et c’est là un aspect
intéressant et tout à fait réel pour le coup) le colonel Dax est prêt à se
battre, il ne remet pas en question son rôle de soldat, ni le fait de partir au
combat et de risquer sa vie au front. Ce qui le révolte c’est le massacre
inutile de ses hommes. Ce n’est donc pas un film pacifiste mais c’est un film
antimilitariste qui dénonce le fonctionnement de l’armée.
Il y a encore un dernier aspect qui
apparaît dans le film (et dont il n’est pas sûr que Kubrick ait eu complètement
conscience) : l’attaque est dirigée non pas contre l’armée en général mais bien
contre l’armée française. Certes le héros Dax est français, mais il l’est bien davantage
sur le script du scénario que sur l’image : K. Douglas est on ne peut plus
américain, quand les généraux qui lui font face (A. Menjou notamment) sont tout
à fait français à l’image.