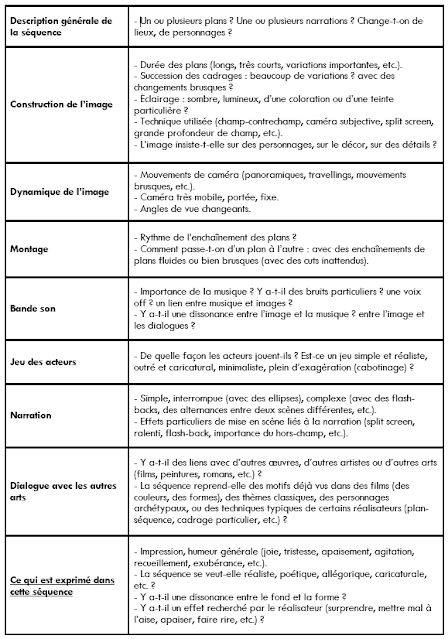Martin McDonagh
n’a réalisé que peu de films mais ils sont assez variés – aussi bien dans leur
qualité que dans leur genre – et le réalisateur a tendance à se bonifier
puisqu’après avoir successivement réalisé un premier film bien terne (Bons baisers de Bruges) et un deuxième
largement oubliable (Sept psychopathes),
Les Panneaux de la vengeance était
réussi. Avec Les Banshees d’Inisherin,
si l’originalité apparente du sujet, sa belle interprétation et son cadre
magnifique masquent un discours très convenu, il faut néanmoins reconnaître que
McDonagh procède d’une manière insolite pour parler de la guerre. C’est que, derrière
la discorde entre deux amis, le réalisateur a autre chose en tête.
Le film s’ouvre sur une brouille entre deux amis, brouille traitée sur un mode semi-comique du fait de
la personnalité de Pádraic parfaitement campé par Colin Farrell. Cette première
partie est très réussie, le spectateur plongeant sur fond de folklore irlandais
dans un univers loin de tout, sur cette petite île à la beauté sauvage, aux
chemins rocailleux et aux murets de pierres. Mais on ignore s’il s’agit d’une
accroche ou bien si l’on tient là le cœur du film. Le doute est levé lorsque
Colm s’inflige des automutilations, ce qui donne au propos une tension à la fois dramatique et très violente. C’est que le film cherche avec une certaine
réussite à mélanger les tons, avec des plans ou des remarques comiques au
milieu d’une humeur générale lourde et réaliste, même si le film tombe par
moment dans le Grand-Guignol (Colm qui vient jeter ses doigts coupés sur la
porte de Pádraic). L’interprétation
est un beau point fort avec Colin Farrell qui tient très bien un rôle difficile :
son personnage un peu simplet se modifie peu à peu pour basculer en fin de film
dans une haine définitive épaissie d'une complexité psychologique qu'il n'avait pas. L’acteur parvient à ne pas trop en faire et le film
repose beaucoup sur sa performance.
Cela dit, si McDonagh
capte très bien la beauté sauvage de l’Irlande, il n’en montre pas sa rigueur et
sa dureté, dureté qui aurait servi son propos. Le paysage évoque d’ailleurs La Fille de Ryan, où la nature servait un film romantique, loin du ton des Banshees d’Inisherin. Ici on ne voit guère qu’une Irlande verte et
ensoleillée et non pas une terre âpre, austère, froide, humide ou venteuse,
Irlande qui rendrait les hommes durs, les fermerait et scellerait leurs
visages.
Dans cette île
d’Inisherin qui est une petite Irlande, la métaphore de la guerre civile –
métaphore qui reste discrète tout au long du film – est clairement assumée dans
la dernière séquence du film. On y voit les deux amis irréconciliables
qui parlent de la guerre au loin mais on comprend qu’il parle d’eux et de
la haine qui, désormais, les sépare. Et quand ils s’en retournent chacun de
leur côté, ils sont séparés, dans le plan, par la vieille femme qui symbolise
la mort. Le dialogue est ici très habile (ils commentent la guerre au loin –
disant qu’elle ne se terminera jamais – mais, en fait, ils parlent de leur
guerre entre eux deux) alors que le film, tout du long, a fait exactement le
contraire : en parlant de ces deux amis dont la fâcherie vire à la haine,
c’est de la guerre civile dont il est question. Et cette métaphore est très
bien tenue : la guerre civile, nous dit le film, naît entre frères, sans
raison véritable, elle est excessive, délirante et sanglante.
L’automutilation
est une image parfaite d’un peuple qui s’entretue et la haine, en fin de film,
a pris place à l’amitié : il n’y a plus de réconciliation possible, tout
ce qui pouvait unir a été balayé. Ce qui se joue dans cette petite île au large
de l’Irlande reflète parfaitement ce qui se joue là-bas, sur la grande île, et dont on
n’entrevoit que quelques échos et quelques explosions au loin.
Cela dit – et
c’est là que le bât blesse et que le film déçoit –, même si la métaphore est
très bien menée, si le film est, en définitive, une fable sur la guerre et qu'il montre très bien le passage de la gentillesse à la haine chez Pádraic (soit le passage de la paix à la guerre sans concession), on est un peu navré que le réalisateur ne dise rien d’autre sur
la guerre que des banalités : la guerre n'a aucun sens, nous dit-il, elle est inutile et horrible. Difficile, en définitive, de faire plus convenu.