







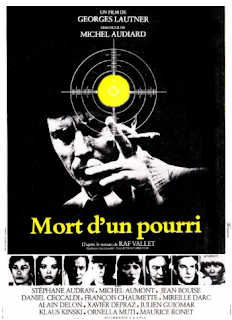



(1) : On notera que ce procédé,
s’il est célèbre depuis Kurosawa, est moins efficace que le jeu de
champ-contre-champ, tel qu’il apparaît dans Mademoiselle par
exemple, où la deuxième partie du film n’est pas l’interprétation d’un même
épisode mais son complément. Elle est ce qui manque à la première, comme deux
pièces de puzzle qui s’emboîtent.




















Si Les Racines du monde nous emmène en Mongolie, passé
l’exotisme de la situation (la vie dans les yourtes, les trajets pour aller à
l’école, les mineurs qui exploitent de pauvres trous creusés dans le sol), le
sujet apparaît assez pauvre et, surtout, très naïf.
Si le rapport au père était intéressant dans la première partie du film, ce
père disparaît très vite. Et le concours de chanson (dont on se doute qu’il
sera décisif) est oublié très longtemps et devient seulement un artifice
scénaristique peu convaincant.
Le film saisit bien des paysages, en cherche la beauté et l’ancrage des
siècles, mais lorsque l’on voit le jeune Amra saboter les moteurs des machines
en pensant influer la marche du monde, on comprend que le film se fourvoie.
On est bien loin de la réussite de Où est la maison de mon ami ?, qui permettait au spectateur d’épouser le drame de l’enfant (drame, qui, dans une
vision d’adulte, n’en est pourtant pas un). Ici c’est tout le contraire :
on voit Amra se réjouir d’avoir mis en panne un moteur, mais l’on sait bien que
cela ne changera rien à ce qui se joue dans la steppe (les troupeaux des
nomades seront repoussés par l’arrivée des sociétés minières qui viennent
exploiter les sous-sols). On est donc dans l’exact opposé du film de
Kiarostami : au lieu de nous amener à ressentir ce que ressent l’enfant,
on juge à l’aune d’un adulte ce que l’enfant perçoit. Si Byambasuren Davaa nous
donne à voir un enfant qui vit ses drames (la disparition du père, ses
détresses, ses renoncements), elle ne parvient pas à filmer à hauteur d’enfant,
ce que Kiarostami faisait de façon éblouissante.
